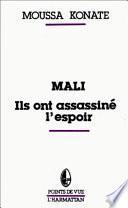
Trouver votre ebook...
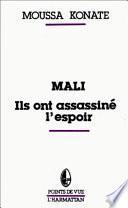
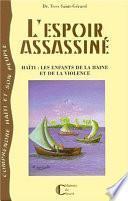
L'espoir assassiné
Auteure: Yves Saint-gérard
Nombre de pages: 182
Eugène Varlin, chronique d'un espoir assassiné
Auteure: Michel Cordillot
Nombre de pages: 284
Le cri du peuple: L'espoir assassiné
Auteure: Jacques Tardi , Jean Vautrin
Nombre de pages: 88Suite de l'adaptation du roman de Vautrin, qui fait revivre le Paris de la Commune de 1871, avec ses crimes, ses joies et ses amours, en particulier celui que porte Antoine Tarpagnan à Caf'Conc'. Avec toujours Grondin, La Joincaille et sa bande, les communards...

Dictionnaire des littératures policières
Auteure: Claude Mesplède
Nombre de pages: 1098Dictionnaire des littératures policières à vocation encyclopédique proposant aussi bien des articles sur les thèmes caractéristiques du genre policier que sur les collections, les magazines, les auteurs (notices biobibliographiques), les personnages, etc.
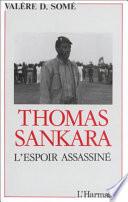
Thomas Sankara
Auteure: Valère D. Somé
Nombre de pages: 238
Afrique-Asie
Nombre de pages: 1006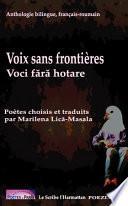
Voci fără hotare, roumain ; moldave
Auteure: Marilena Lică-masala
Nombre de pages: 458
Lettres maliennes
Auteure: Sébastien Le Potvin
Nombre de pages: 342Pour cerner les conditions et les enjeux de la littérature écrite au Mali, il est nécessaire de retracer les grandes étapes d'une histoire parfois douloureuse. La littérature malienne n'avait jusqu'à présent bénéficié d'aucune étude approfondie. Même les écrivains du Mali les plus illustres, Yambo Ouloguem, Amadou Hampaté Ba, Massa Makan Diabaté, Irahima Ly, demeurent, au fond, méconnus ou mal compris. En dépoussiérant ces figures de quelques idées reçues, se dévoilent une même volonté, imposer la tradition de l'écrit, et une même tentation, la liberté.

L'espoir assassiné
Auteure: Anne Doubre De Alarcón
Nombre de pages: 64
Gazette générale de l'Europe

Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger
Nombre de pages: 1836
La conjuration Nobel
Auteure: Michel Martin-roland
Nombre de pages: 428Thriller saisissant de vérité ds les coulisses du pouvoir ...
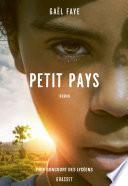
Petit pays
Auteure: Gaël Faye
Nombre de pages: 224En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français... « J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous...
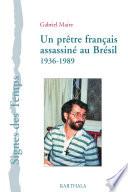
Un prêtre français assassiné au Brésil 1939-1989
Auteure: Maire Gabriel
Nombre de pages: 288Cahier photos couleurs de 16 pages Né dans le Jura en 1936, prêtre du diocèse de Saint Claude en 1963, Gabriel Maire y a exercé son ministère dix-sept ans. D’abord en paroisse à Dole, en même temps qu’il était aumônier de lycée ; puis à Saint Claude comme vicaire à la cathédrale, avec un engagement dans la pastorale ouvrière et dans l’animation d’un quartier populaire. Plei¬nement inséré dans ces engagements en France, pourquoi Gabriel est-il parti en Amérique latine en 1963 ? Un départ qui ne doit rien au hasard mais se présente comme le fruit de deux enracinements. L’un dans sa foi vivante en la personne de Jésus ; l’autre dans son engagement politique à travers le « Mouve¬ment populaire des citoyens du monde » qu’il avait lui-même créé. Cette double dimension de sa vie lui a fait très vite envisager d’aller là où il y avait moins de prêtres que dans sa région d’origine, le Jura. Sa destination – l’Amérique latine – est aussi le fruit de sa rencontre avecDom Helder Camara, évêque de Recife au Brésil. Ces deux lignes de force et cette rencontre vont marquer sa présence au service des plus pauvres du Brésil, pour les...
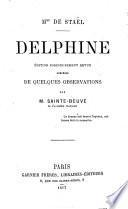
Delphine
Auteure: Germaine De Staël
Nombre de pages: 638
Delphine
Auteure: Staël
Nombre de pages: 654
Delphine
Auteure: Madame De Staël (anne-louise-germaine)
Nombre de pages: 608
Histoire politique et littéraire de la presse en France
Auteure: Eugène Hatin
Nombre de pages: 580
Histoire politique et littéraire de la presse en France avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leurs origines
Auteure: Eugène Hatin
Nombre de pages: 560
Histoire politique et littéraire de la presse en France, 6
Auteure: Eugène Hatin
Nombre de pages: 564
Œuvres de Madame la baronne de Staël-Holstein
Auteure: Madame De Staël (anne-louise-germaine)
Nombre de pages: 900
Oeuvres de madame la baronne de Staël-Holstein
Auteure: Germaine De Staël-holstein
Nombre de pages: 954
Delphine
Auteure: Baroness Anne Louise Germaine De Rocca (formerly Staël-holstein.)
Nombre de pages: 636
Delphine
Auteure: Germaine De Staël-holstein
Nombre de pages: 630
Delphine M.me de Staël
Auteure: Anne Louise Germaine : Baronne De Staël-holstein
Nombre de pages: 608
L'espoir
Auteure: André Malraux
Nombre de pages: 448ŤLe livre de Malraux reflčte fidčlement le désarroi, les promiscuités et les atrocités d'une révolution ; mais il en exprime aussi la conscience, le sens, le mouvement souterrain. Et c'est parce qu'il ne cache rien des horreurs et des niaiseries de la guerre civile, qu'il charge son titre d'une valeur singuličre. Voici les fautes, voici les sots, les mercenaires, les guerriers, voici le doute qui prend le plus résolu quand, ŕ l'instant de mourir, il sent que son corps était beau ; mais voici cette attente, cet appel, cette recherche, on ne sait au juste de quoi, de quelque chose qui efface le passé, d'une communion plus intime dans le danger, la lutte, la souffrance, d'une patrie, d'une gestation, d'une justification par le sacrifice ; - l'espoir.ť.

Bibliographie commentée des écrivains contemporains
Nombre de pages: 124
Oeuvres Comple`tes de Mme la Baronne de Stae ̈l
Auteure: Baroness Anne Louise Germaine De Rocca (formerly Stae ̈l-holstein.)
Nombre de pages: 1010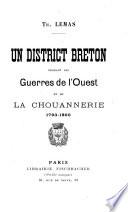
Un district Breton pendant les guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, 1793-1800
Auteure: Théodore Lemas
Nombre de pages: 388
Philippe Daudet a bel et bien été assassiné
Auteure: René Breval
Nombre de pages: 196Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
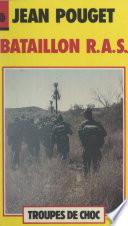
Bataillon R.A.S. Algérie
Auteure: Jean Pouget
Nombre de pages: 488Algérie, octobre 1956. Le chef d’escadron Jean Pouget, alias Jean-Marie, est brusquement désigné pour prendre le commandement “du plus pouilleux des bataillons d’infanterie”, la honte de la Grande Famille que l’on cache aux étrangers dans les montagnes désertiques du Sud, en disant de lui : “R.A.S.” ! Ce livre révèle ce que recouvre la pudique formule “rien à signaler” : une histoire d’hommes dans la guerre, avec leurs sordides calculs, leurs élans sublimes, leur courage lors de grandes opérations auxquelles rien ne les avait préparés. Investi des pleins pouvoirs par le haut commandement, dépouillé de toute ambition de carrière, le jeune commandant Jean-Marie acquiert sur ses hommes une telle emprise qu’il les entraînera irrésistiblement derrière lui vers une grande aventure d’Homme. Le commandant Jean-Marie apporte son acquis indochinois dans cette guerre africaine et fatalement il sera amené à l’action politique : “Pénétrer en terrain ennemi, violer le monopole du civil”. Cette voie le conduira logiquement à prendre part au mouvement du 13 mai 1958.
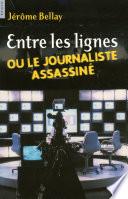
Entre les lignes ou le journaliste assasiné
Auteure: Jérôme Bellay
Nombre de pages: 234Vincent Delorme est grand reporter à la télévision : un baroudeur qui a couvert les grands événements de la planète. Alors qu'il dédicace son dernier livre, il est assassiné d'un coup de revolver. Le tueur s'enfuit en laissant son arme. Pas d'autres indices. L'opinion, les milieux politiques et professionnels sont en émoi, car c'est un journaliste vedette qui vient d'être froidement abattu. L'enquête piétine... jusqu'au moment où l'une des ses consœurs, présentatrice du 20 heures, imagine que c'est dans le livre qu'il dédicaçait que se tient la clef de l'énigme. Ou plutôt entre les lignes de cet ouvrage. Dans ce nouveau thriller, Jérôme Bellay décrit au plus près et sans concessions le milieu du journalisme, qu'il connaît sur le bout des doigts. Mais surtout, et c'est l'attrait principal de ce roman, nous découvrons certains aspects peu reluisants de l'envers du décor. Toute ressemblance avec des personnages et des faits réels n'est peut-être pas tout à fait fortuite...
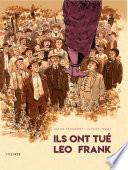
Ils ont tué Leo Frank
Auteure: Xavier Bétaucourt
Nombre de pages: 1131913. Le corps de Mary Phagan, 14 ans à peine, est retrouvé dans l’usine dans laquelle elle travaillait. Elle a été étranglée. Près d’elle deux bouts de papier sur lesquels, agonisante, elle aurait écrit que son violeur et assassin est un homme noir. La police identifie rapidement deux suspects : Leo Frank, le patron de l’usine qui est le dernier à l’avoir vue vivante et Jim Conley, balayeur, noir, surpris en train de laver une chemise tachée de sang... Qui du jeune et riche patron juif venu de Boston ou du pauvre employé noir illettré sera inculpé ? Dans ce récit tout est vrai. L’affaire, l’emballement de la presse, les mots, terribles, prononcés au procès, le témoignage, au crépuscule de sa vie d’Alonzo Mann... La résonance avec l’époque actuelle aussi...

Le cri du peuple
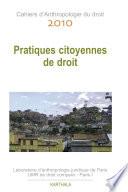
Pratiques citoyennes de droit
Auteure: Etienne Le Roy
Nombre de pages: 338À l'échelle mondiale, il y a une cinquantaine d'années, les anthropologues du droit ont commencé à traquer les multiples manifestations du droit dans ses pratiques les plus quotidiennes. Depuis vingt ans, le Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris (LAJP-UMR de droit comparé) s'est allié à l'association Juristes-Solidarités pour conjuguer leurs savoir-faire et enrichir leur travail d'interprétation à la lumière des logiques des acteurs du droit qu'ils côtoyaient. La réalisation d'un programme de recherche-action sur les pratiques citoyennes de droit, facteur de transformation sociale, dans le cadre d'un PICRI (Partenariat institutions citoyens pour la recherche et l'innovation) financé par la Région île-de-France, à travers des rapports de recherche sur le terrain, une vidéo et quelques-uns des articles réunis ici, ont illustré que le droit n'est pas seulement une institution de mise en ordre de la société mais bien un outil puissant de démocratisation locale et de protection des individus des excès de tout pouvoir, à condition de le vouloir. Six associations, françaises et étrangères, ont relevé le pari d'une sorte de radiographie de leurs...
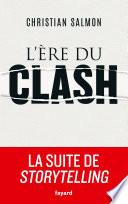
L'Ere du clash
Auteure: Christian Salmon
Nombre de pages: 384Un ouragan emporte nos sociétés hyperconnectées et hypermédiatisées. Le vent a tourné, nous l’éprouvons tous fortement. L’époque n’est plus tout à fait, ou seulement, à la manipulation et au formatage des esprits, comme encore au milieu des années 2000, quand régnait sur le discours médiatico-politique le storytelling. L’explosion du Web, l’éclosion des premiers réseaux sociaux créaient l’environnement favorable à la production et à la diffusion d’histoires. Or, de même que l’inflation ruine la confiance dans la monnaie, l’inflation des stories a érodé la confiance dans les récits. Le triomphe de l’art de raconter des histoires, mis au service des acteurs politiques, aura entraîné, de manière fulgurante, le discrédit de la parole publique. Cette défiance est aujourd’hui revendiquée par les hommes politiques eux-mêmes. Christian Salmon nous montre les logiques qui nous ont conduits à la confusion actuelle. Dans le brouhaha des réseaux et la brutalisation des échanges, la story n’est plus la clé pour se distinguer. La conquête de l’attention, comme celle du pouvoir, passe désormais par l’affrontement, la rupture, la...

Histoire politique et militaire du peuple de Lyon pendant la Révolution française
Auteure: Alphonse Balleydier
Nombre de pages: 462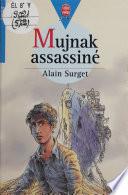
Mujnak assassiné
Auteure: Alain Surget
Nombre de pages: 156Mujnak se meurt. Il y a trente ans, cette ville de 42 000 habitants se trouvait au bord de l'Aral. Aujourd'hui, Mujnak est dans le sable les cargos rouillent dans le désert, véritables squelettes de ferraille. Et puis une accablante pollution gangrène la région. Face à cette catastrophe écologique sans précédent, ce Tchernobyl silencieux, deux adolescentes — Gengis et Djazia — vont tenter de ramener la mer.

La Dialectique du beau et du laid dans Le Poète assassiné etCalligrammes de G. Apollinaire
Auteure: Gilberte Jacaret
Nombre de pages: 202Tout d’abord, imposer entre soi et le monde une rupture, une brisure. Puis, de par cette position, porter un regard intact sur ce dernier et voir émerger de nouvelles valeurs. Enfin, s’employer à réunir ce qui était séparé, à fusionner ce qui était opposé. Ce mouvement en trois temps, Gilberte Jacaret le repère au sein du "Poète assassiné" et de "Calligrammes" d’Apollinaire, et en fait le thème de la présente étude qui, avec minutie et précision, met à jour les mécanismes littéraires par lesquels le poète dessine les contours d’un univers réinventé. Participant d’une lecture des textes apollinariens menée avec acuité, s’appuyant sur une autopsie pointue des procédés littéraires mis en place par l’auteur, dévoilant l’infinie richesse de vers à l’esthétique bouleversée, la thèse de Gilberte Jacaret se distingue par cette écoute attentive des textes poétiques. Situé ainsi au plus près de cette oeuvre, ce travail critique, qui allie technicité et sensibilité, constitue une voie d’accès éclairante à une poésie aujourd’hui devenue incontournable.
Plus d'informations