
Trouver votre ebook...


Revue algérienne, tunisienne et coloniale de législation et de jurisprudence
Auteure: Robert Estoublon , Marcel Morand
Nombre de pages: 1032
Dictionnaire de la législation tunisienne
Auteure: Tunisia
Nombre de pages: 663
Revue tunisienne de sciences sociales
Nombre de pages: 1190
Les Cahiers de Tunisie

Aux origines du commerce français en Tunisie
Auteure: Mongi Smida
Nombre de pages: 221
Dictionnaire de la législation tunisienne
Auteure: Auguste Sebaut
Nombre de pages: 676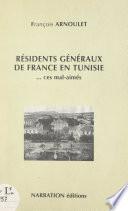
Résidents généraux de France en Tunisie... ces mal-aimés
Auteure: François Arnoulet
Nombre de pages: 270Écrire un livre sur les résidents généraux de France en Tunisie, et faire apparaître l’homme à partir de sa carrière politique et administrative, ses réflexions et sa correspondance privée, revenait à rendre un devoir à ces bâtisseurs d’un système, le protectorat, montage diplomatique complexe et fragile. Le Résident général - appelé parfois Proconsul - fut le pivot central de cette dyarchie, où il fallait à la fois assurer un équilibre précaire entre un gouvernement français - souvent malhabile - et une monarchie théocratique égoïste, composer entre un peuple tunisien avide d’émancipation, des Français impatients et des minorités étrangères revendicatrices de leurs droits. Il lui fallut imaginer, entreprendre et assurer le développement technique et culturel d’un pays, pour le mettre à l’heure du XXe siècle, tout en étant attentif aux problèmes locaux qui se présentaient quotidiennement. Cette tâche, positive et civilisatrice, dut éviter certains errements qui avaient été commis dans la colonie voisine : l’Algérie. Enfin, le dépositaire du principe du protectorat, le Résident général, dut - envers et contre tous, Tunisiens...

Annales tunisiennes
Auteure: Alphonse Rousseau
Nombre de pages: 582
Les Italiens dans la Tunisie contemporaine
Auteure: Romain Rainero
Nombre de pages: 251L'histoire de la présence italienne en Tunisie a été depuis presque un siècle au cœur des études des relations franco-italiennes mais souvent, trop souvent, disons même presque toujours, ce sont les grands moments de la politique des États, des revendications et des ruptures qui ont occupé la grande scène de cette histoire qui a délaissé d'évoquer bien des aspects de la vie de la société des quelques 170.000 Italiens de Tunisie. Et pourtant, nous pouvons cueillir des accents d'intérêt certain sur la vie intime de cette population oubliée, sur certains hommes de cette foule anonyme qui ont marqué par leurs actions et par leur exemple, l'histoire de ces non-protagonistes et qui ont donné à la longue période de la présence italienne en Tunisie, qui a grossi entre les deux grandes guerres, une signification et une importance que tout historien ne peut manquer de devoir souligner et de rappeler. Et c'est dans cette optique que désire se situer notre volume qui se veut une honnête contribution à un discours fait trop rarement sur les hommes, sur les situations et sur l'intimité de cette colonie, qui, loin d'être le péril italien que les colons français dans ...

Recensement général de la population de la Tunisie du 1 février 1956
Auteure: Tunisia. Service Des Statistiques
Nombre de pages: 191
La Tunisie de 1939 à 1945
Nombre de pages: 356
Journal des tribunaux français en Tunisie
Auteure: Tunisia
Nombre de pages: 688
Essai de Compréhension d'un Vécu Politique en Tunisie Post - Révolutionnaire
Auteure: A. Belhadj
Nombre de pages: 128Deux moments-vécus sont constitutifs de ces conditions objectives : le premier moment est représenté par les évènements réels produits à la rue « B?b bn?t » le jour du procès d’une chaine télévisée pour sa diffusion du film « Persépolis ». Il était impossible pour ceux qui, en ce moment, voulaient passer de « B?b la‘loudj » à la « ?asbah » ou à « Bab Mn?ra », de ne pas sentir la tension qui régnait dans les lieux. Le deuxième moment fut lorsque, le lendemain, nous avons vu, à la une de l’un des quotidiens tunisiens, une photographie de ce qui s’est passé à « B?b-bn?t ». Deux « vécus » donc. L’un consiste au fait d’assister à une situation conflictuelle et tendue et l’autre au fait de voir affichée, chez les vendeurs de journaux, une représentation qui la fige en une photographie. Du point de vue de l’observateur commun, une grande différence sépare ces deux vécus. Témoin réel de la situation, celui qui s’y trouvait présent ne pouvait pas ne pas se demander : Que se passe-t-il ? Qui sont-ils ? Qui a agressé l’autre ? Pourquoi ? ... Et cette suite de questions, faisant inconsciemment intégrer le contexte de pertinence ...

Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement: Tunisie 2012
Auteure: Oecd
Nombre de pages: 166Cette examen présente le rôle de l’ investissement direct étranger dans le développement économique de la Tunisie, analyse le régime d’investissement en vigueur et les exceptions au traitement national et est axé sur les mesures prises dans le cadre de l'application des Principes directeurs pour les entreprises multinationale.

De l'évolution du protectorat de la France sur la Tunisie
Auteure: Louis Foucher
Nombre de pages: 310
Annuaire statistique de la Tunisie
Nombre de pages: 336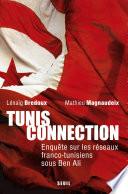
Tunis Connection. Enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali
Auteure: Lénaïg Bredoux , Mathieu Magnaudeix
Nombre de pages: 262Le 14 janvier 2011, Ben Ali fuit la Tunisie, qu'il a gouvernée d'une main de fer pendant vingt-trois ans. Le pays vient de faire sa révolution, premier acte du printemps arabe, saluée par le monde entier. La France officielle, elle, reste pétrifiée et défend jusqu'au bout le dictateur. Comment expliquer que jusqu'à la fin, et au plus haut sommet de l'État, la France ait affiché son plus total soutien à Ben Ali et à son clan ? Telle est la question à laquelle répond ce livre édifiant : à droite comme à gauche, on ne compte plus les responsables politiques et diplomates qui ont tissé des liens étroits avec la dictature de Carthage, les entreprises françaises qui ont prospéré grâce à leurs liens avec la mafia de Tunis. Quant aux médias et aux intellectuels jusqu'au monde de la culture, ils sont nombreux ceux qui se sont fait les apôtres du régime de Ben Ali. Il faut dire que certains hôtels de luxe de Tunis sont particulièrement accueillants... Corruption et affairisme, réseaux politiques, liens d'amitiés : depuis la révolution, ceux qui, en Tunisie, vivaient dans la peur acceptent aujourd'hui de parler, le voile trop longtemps jeté sur les...

Institutions administratives et droit administratif tunisiens
Auteure: Michel Durupty
Nombre de pages: 408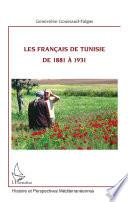
Les Français de Tunisie de 1881 à 1931
Auteure: Geneviève Goussaud-falgas
Nombre de pages: 372Devenue protectorat le 12 mai 1881, la Tunisie a dès lors connu une réorganisation sur des bases politiques et économiques nouvelles par la France. Un peuplement français s'est alors constitué. C'est son histoire qu'étudie cet ouvrage : sa lente formation, l'oeuvre qu'il accomplit, ses courants d'opinion, ses rapports avec les Tunisiens et les diverses communautés, son intégration dans le pays - dont 1931 marqua l'apogée - parallèlement à la montée du nationalisme tunisien, prélude à l'indépendance, en 1956, et à l'éviction des Français.
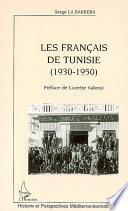
Les Français de Tunisie
Auteure: Serge La Barbera
Nombre de pages: 405Les populations françaises de Tunisie, composées de Français métropolitains, de Français nés en Tunisie, d'Italiens ayant opté pour la nationalité française, de Maltais et de Tunisiens également, juifs mais aussi musulmans, ont formé une communauté diverse tant par sa culture que par ses comportements au quotidien. Voici un éclairage sur la France de la Seconde Guerre mondiale depuis "le balcon du Maghreb", sur l'histoire coloniale.

Oeuvre financière du Proctecorat français en Tunisie ; Régime douanier et produits monopolisés ; Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens ; Sociétés indigènes de prévoyance
Auteure: Tunisia. Direction Général Des Finances
Nombre de pages: 105
Actions de productivité en Tunisie
Auteure: Mission De Productivité En Tunisie
Nombre de pages: 56
Les Confins saharo-tripolitains de la Tunisie (1881-1911) ...
Auteure: André Martel
Nombre de pages: 428
Record of proceedings
Nombre de pages: 1498
Annales
Auteure: France. Parlement (1946- ). Assemblée Nationale

Les politiques de développement en Tunisie
Auteure: Aude-annabelle Canesse
Nombre de pages: 273Participation et gouvernance sont autant de thématiques renouvelées ces dernières décennies sur la scène du développement international, et illustrées sous l’ère Ben Ali par la mise en œuvre des Groupements de développement agricole (GDA). En conjuguant l’Analyse des politiques publiques et les Development Studies et en inscrivant les recherches dans une perspective diachronique et synchronique, l’ouvrage propose un panorama global et multiscalaire des politiques, institutions et outils de gestion du développement, identifiant les enjeux nationaux et internationaux. Préalablement, le terrain est articulé avec la méthodologie : en effet les conditions d’une recherche réalisée sur et au cœur de l’action publique révèleront rapidement, et en filigrane, la sensibilité de ces thématiques et la nécessité pour le chercheur d’identifier les moyens de naviguer sur le terrain et de contourner les stratégies d’encadrement à l’œuvre dans un système autoritaire. Plus allant, le développement apparaîtra comme un mode d’encadrement du territoire et des populations, et de captation des ressources, assurant la pérennisation d’un système et de...

IBLA
Nombre de pages: 438
D'une maison l'autre
Auteure: Philippe Bonnin , D. Arbonville
Nombre de pages: 371
Les Projets de toute une vie
Auteure: Madjid Chaker
Un parcours professionnel jalonné d’expériences aussi enrichissantes que variées, c’est ce que nous propose de découvrir Madjid Chaker, brillant ingénieur d’origine algérienne. Dès l’enfance, il se passionne pour la conception d’objets en tous genres. Plus tard, ses aptitudes en mathématiques le conduisent à s’inscrire dans la filière Sciences au lycée, avant d’intégrer l’École Nationale Polytechnique d’Alger. Son diplôme en poche, il va mener différents projets industriels d’envergure qui le conduiront aux quatre coins du globe. Malgré des conditions de travail parfois difficiles et de nombreuses embûches auxquelles il devra faire face, la passion qui l’anime pour la réalisation de ses projets ne le quittera jamais. À l’heure de la retraite, il décide de transmettre et restituer son savoir aux futurs créateurs d’entreprises. Dans ce livre, véritable guide de développement personnel, l’auteur veut, par le biais de sa propre expérience, conduire le lecteur à s’interroger sur les motivations qui le poussent à entreprendre et à réaliser des projets auxquels il croit.

Banque de Tunisie
Auteure: Bank Al-markazī Al-tūnisī
Nombre de pages: 16
Pouvoir et société dans la Tunisie de Hʼusayn bin ʼAlî, 1705-1740
Auteure: Mohamed-hédi Cherif
Nombre de pages: 385
Eusèbe Vassel, historien de la littérature judéo-arabe tunisienne
Auteure: Robert Attal
Nombre de pages: 15
La transition de la fécondité en Tunisie
Auteure: Frédéric Sandron , Bénédicte Gastineau
Nombre de pages: 264Cas unique parmi les pays arabo-musulmans, la Tunisie a mis en place très tôt une politique de planification familiale. La baisse de la fécondité survenue dès le milieu des années 1960 la classe aujourd'hui au niveau des pays européens. Cet ouvrage présente le cheminement de la fécondité durant quarante ans, en analysant le rôle du recul de l'âge au mariage et de la contraception dans cette transition démographique, mais aussi en montrant les changements dans les stratégies reproductives. Ceux-ci s'expliquent par l'ouverture à l'économie de marché, la disparition de l'hégémonie du secteur agricole, l'évolution du statut de la femme, le moindre rôle de la famille élargie, la politique de population de l'Etat ainsi que les réformes sociales et juridiques. En d'autres termes, l'évolution de la fécondité est avant tout une affaire de société.

L'espace tunisien
Auteure: Pierre Signoles
Nombre de pages: 566
La vie littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937
Auteure: Yves Chatelain
Nombre de pages: 342Plus d'informations