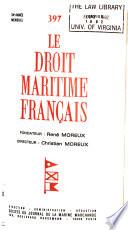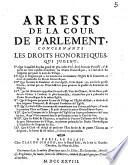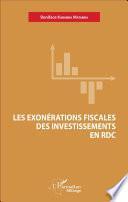
Les exonérations fiscales des investissements en RDC
Auteure: Boniface Kabanda Matanda
Nombre de pages: 830La concurrence fiscale comme mesure incitative ou attractive des investissements directs étrangers s'est révélée inefficace. Cette leçon a servi d'exemple à l'Etat Indépendant du Congo et à la Colonie Congo-Belge qui limitèrent la défiscalisation aux seuls grands projets de développement orientés dans la logique de l'économie mixte. Dès lors, nous voilà dans l'institutionnalisation de l'injustice fiscale qui nous fait assister impuissants à la création simultanée de l'enfer fiscal, du purgatoire fiscal et du paradis fiscal en RDC. Au total les investissements directs étrangers en appellent plutôt à la globalité des politiques publiques et privées.