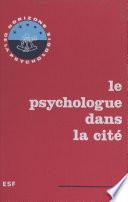
Le psychologue dans la cité
Auteure: Didier Anzieu , Pierre Bessis , Simone Buffard
Nombre de pages: 216Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
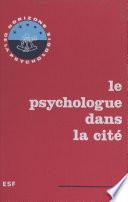
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.

Ce livre est le fruit d'entretiens entre un psychanalyste et un enseignant. D'une discipline à l'autre, d'une langue à l'autre, l'arabe et le français, des questions très diverses y sont abordées, au plus près de préoccupations contemporaines. On y trouvera des réflexions sur le changement social, la jeunesse, l'éducation, la sexualité, la place du religieux, le champ de la création littéraire et artistique... Pourquoi cet ouvrage ? Il a initialement été écrit pour informer. Il répond à une demande, une attente. Pas un jour sans que les médias ne soulèvent un sujet ayant trait à des histoires personnelles, à des témoignages, à des avis de "psy" de tous bords. L'information doit gagner en rigueur. Quel "psy" ? La psychanalyse n'est pas la psychiatrie, la psychologie, la sociologie, le coaching... Elle n'a sûrement pas réponse à tout, mais elle apporte un éclairage différent lié à d'autres champs de recherche. Ce livre s'inscrit dans le cadre de débats actuels en sortant des cercles spécialisés, en décloisonnant les disciplines, en étant à l'écoute des préoccupations citoyennes quotidiennes au Maroc.

C'est le versant épistémologique de l'oeuvre de Gaston Bachelard que se propose de sonder et d'éclairer la réflexion conduite par J-F Minko M'Obame. Une patiente et minutieuse exploration de la pensée du philosophe se met ainsi en branle, se développant à partir de la notion de sujet - et notamment de sujet pensant - pour atteindre par extension ce que sont la raison, et plus loin, le rationalisme pour cet auteur majeur, père d'une production philosophique majeure pour le XXe siècle et les sciences. Un essai indispensable pour entendre la spécificité de Bachelard, la construction de sa pensée scientifique, ses vues sur l'histoire des sciences ; un ouvrage qui, sans dénouer toutes les interrogations posées sur cette oeuvre, apporte une pierre fondamentale à sa réception. Un essai qui " s'approche " de la pensée bachelardienne pour mieux cerner la vision que le philosophe porte sur l'homme de raison et de sciences. Un travail de longue haleine, mené à partir d'une indubitable connaissance de l'oeuvre du penseur, de ses discours et de ceux portés sur lui, sur lequel les familiers de ses théories et idées - voire même ceux qui les mettent en crise - ne pourront...
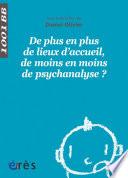
Découvrir l’actualité de la psycha-nalyse dans les lieux d’accueil parents-enfants en France et à l’étranger, 35 ans après Dolto et la Maison verte de Paris. Françoise Dolto n'a jamais souhaité faire école, « produire » des élèves, mais son travail a enseigné et/ou inspiré de nombreux professionnels de l'enfance ! De la même façon, la Maison verte n’est pas un modèle, mais elle nourrit la réflexion de dizaine d’équipes en France et à l’étranger. Cet ouvrage fait état de leur projet et de leur parcours singulier. Daniel Olivier est psychanalyste à Caen (Calvados), cofondateur et accueillant à Ricochet (1986-2000), accueillant à l’IRAEC (Paris 2000-2010) ; il est membre des Archives Françoise Dolto (Paris) et président fondateur de l’AFDIM (Association Françoise Dolto ici et maintenant, Caen). Mise en vente le 27 septembre 2012

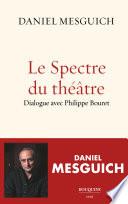
Daniel Mesguich est tout à la fois metteur en scène, comédien, acteur et professeur d'art dramatique... Il parle ici admirablement de cet art dont il est un des maîtres incontestés. " Le théâtre est rayonnement sans borne, éternellement infini dans tous les univers, mais ce rayonnement est éphémère. Il vise à l'éternité, mais ne dure chaque fois que deux heures, c'est-à-dire à peu près zéro seconde... Rien ne persiste, pas de traces, rien ne reste. La seule chose ineffaçable, absolument ineffaçable – même quand le soleil, notre étoile, ayant commencé de s'éteindre, il n'y aura plus personne dans l'univers pour s'en souvenir -, la seule chose irrattrapable, même par un dieu tout puissant, c'est le futur antérieur. C'est que ça aura eu lieu... Oui, comme la vie. " Daniel Mesguich
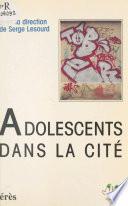
L’adolescence, période de mutation décisive au travers de laquelle l’enfant construit l’adulte qu’il deviendra, a une fonction sociale fondamentale... mais ne va pas sans poser de problèmes : - aux intéressés eux-mêmes fragilisés par les transformations dont ils sont l’objet et qui bouleversent leurs repères identitaires, - aux parents qui doivent accepter de se remettre en cause sans démissionner devant les exigences parfois violemment exprimées de leurs adolescents, – aux responsables et élus politiques qui doivent gérer l’espace communautaire où les jeunes tentent d’imprimer leurs marques, - aux enseignants, travailleurs sociaux et à la société en général qui doit les accompagner dans leurs démarches d’insertion ! En effet, comment permettre aux adolescents de s’instituer dans le social, sans les renvoyer à un avenir hypothétique de travailleurs ou de parents ? Comment répondre à l’urgence sociale que représentent les demandes multiples des adolescents de notre société de consommation et de marché ? Comment se situer face à la montée de la violence dans les cités de banlieues des grandes villes, à l’isolement des campagnes...

Fruit de l'initiative des Facultés universitaires Saint-Louis, le présent ouvrage rend hommage, à l'occasion de son admission à l'éméritat, à Jacques Dabin qui fut titulaire de cours de philosophie morale et de droit naturel depuis 1968 et assura la fonction de Recteur des Facultés de 1973 à 1993. Reflétant à la fois ses préoccupations majeures, ainsi que la diversité des approches correspondant aux différentes composantes des Facultés, cet ouvrage réunit les actes du colloque que les Facultés ont consacré à ce thème du 20 au 22 avril 1994, ainsi que d'autres contributions émanant de membres ou amis des Facultés qui ont accepté de se joindre à cet hommage.
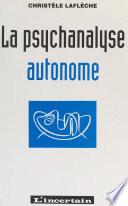
Le reflet de 20 ans de pratique, où le lecteur découvrira les secrets d'une démarche analytique qui respecte l'individu et le conduit vers le mieux-être. « Copyright Electre »
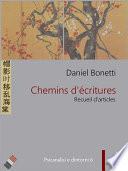
Daniel Bonetti (1950-2015) a cette fois emprunté un chemin de traverse définitif. Le présent recueil vaut dès lors hommage à lui rendu. A défaut de sa voix, qui désormais s’est tue, il nous reste ses écrits. Outre ses livres, notamment L’arbre effeuillé et autres brindilles et Nouvelles d’absence, il a rédigé de nombreux articles. Quelques uns de ceux-ci sont ici rassemblés et présentés dans l’ordre chronologique qui sépare « La scène finitive » (1987) de « Cet obscur objet du bruissement de la langue » (2015). La poésie de ces deux titres n’aura sans doute pas échappé au lecteur. Gageons qu’il pourra, au fil des pages, partir à la découverte de l’héritage que nous a laissé cette plume alerte et qu’il s’en trouvera, de ce fait, relancé dans son propre questionnement. Nous laisserons à Daniel le mot de la fin, à moins que ce soit celui d’un nouveau départ… « Il se lève alors, reprend son bâton de marche et, d'un pas hésitant, il s'éloigne dans la brume du temps ».
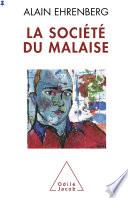
L’émancipation des mœurs, les transformations de l’entreprise et celles du capitalisme semblent affaiblir les liens sociaux ; l’individu doit de plus en plus compter sur sa « personnalité ». Il s’ensuit de nouvelles souffrances psychiques qui seraient liées à la difficulté à atteindre les idéaux qui nous sont fixés. Cette vision commune possède un défaut majeur : elle est franco-française. Comment rendre compte de la singularité française ? Et que signifie l’idée récente que la société crée des souffrances psychiques ? Croisant l’histoire de la psychanalyse et celle de l’individualisme, Alain Ehrenberg compare la façon dont les États-Unis et la France conçoivent les relations entre malheur personnel et mal commun, offrant ainsi une image plus claire et plus nuancée des inquiétudes logées dans le malaise français. Alain Ehrenberg est l’auteur de trois livres sur l’individualisme, Le Culte de la performance en 1991, L’Individu incertain en 1995 et La Fatigue d’être soi en 1998. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, après avoir créé en 1994 un groupement de recherches sur les drogues et les médicaments psychotropes, il a ...
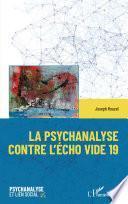
Le terrain privilégié d'intervention du psychanalyste reste et demeure le cabinet. Mais, de temps en temps, il s'intéresse à la politique. Il laisse alors au vestiaire son habit de psychanalyste et endosse celui de citoyen. La position du psychanalyste dans la cité, dépouillé de ses oripeaux et averti de la condition humaine, trouve aussi ses champs d'exploration dans des territoires connexes au travail analytique. Cette réflexion se déroule sur fond de pandémie de Covid-19, qui ne renvoie qu'un « écho vide » à toutes les questions angoissées qui l'accompagnent sans que revienne l'écho d'un Autre sachant. En ce lieu tragique chacun est convoqué pour savoir comment il se débrouille avec un réel qui troue tout savoir. Passer du tout au trou, tel est l'enjeu, si l'on veut que dans les décennies qui suivent le mystère de l'être parlant demeure vivant.

Cet ouvrage collectif dévoile précisément la manière dont Philippe Paumelle a contribué à l’élaboration de la circulaire de mars 1960 permettant la sectorisation psychiatrique. On y découvre la trajectoire d’un homme, très actif, pour lequel agir et prendre soin des malades, notamment des plus difficiles, à une époque où les traitements médicamenteux n’existaient pas ou si peu, a été la motivation, tout au long de sa carrière. Un panorama documenté comme une étude savante et passionnant comme un roman d’aventures

La psychanalyse serait dépassée, dit-on parfois ; et la voici pourtant en pleine expansion vers l’est ! Ses concepts se retrouvent d’ailleurs dans maint champ scientifique ou artistique. Cependant bien des gens voudraient entreprendre une psychanalyse et ne l’osent ou ne le peuvent pas ; il est vrai que rien n’est fait en France pour leur en faciliter l’accès... Serait-ce toujours un privilège des beaux quartiers ? Nulle histoire de la pratique psychanalytique n’est disponible ; et pourtant que de projets et de réalisations originales. Commençant au cabinet de Freud, traversant les premiers instituts et polycliniques, on peut découvrir plusieurs institutions européennes et françaises méconnues. De ce parcours Bernard Sigg déduit des propositions théoriques qui ébranlent certaines idées reçues, tel le « prix » élevé à payer pour qui veut engager une analyse. Soucieux d’éclaircir les rapports de la pensée et de la société, l’auteur s’était successivement tourné vers la neurophysiologie aux États-Unis, puis vers la psychiatrie en France et au Maghreb. L’une et l’autre lui apparurent bientôt comme des impasses. Devenu psychanalyste, il ...

Difficile de classer cet essai un peu désordonné, sur la créativité et l'innovation, où se mêlent des pensées de poètes, des études de cas, de courtes nouvelles, des exemples inspirants et bien d'autres élucubrations. [SDM].
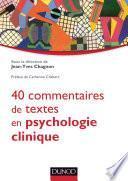
Fille de la philosophie et de la médecine, de la psychologie expérimentale et de la psychanalyse, la psychologie clinique française a parfois pu être considérée comme « l’enfant terrible » de la psychologie de par les débats qu’elle a suscités tout au long de son histoire. Cet ouvrage collectif est l’occasion d’en revoir les définitions, le contenu et les frontières. Reprenant les axes qui définissent la discipline et se voulant l’écho des grands mouvements et des débats qui en ont marqué l’histoire, ce livre ce décline en huit sections : fondations, questionnements identitaires et synthèses, théories et modèles, champs d’intervention, méthodes et outils, objets de connaissance, recherche, profession de psychologue. Les textes retenus sont pour la plupart des « classiques » émanant des fondateurs (Lagache, Favez-Boutonnier, Anzieu), de leurs successeurs (Revault d’Allonnes, Rausch de Traubenberg, Shentoub, Debray), jusqu’aux contemporains (Chiland, Guillaumin, Perron, Kaës, Widlocher, Pédinielli, Gori, Chabert, Roussillon, etc.). Des textes plus récents présentent les nouveaux objets de la psychologie clinique, les articles de loi...
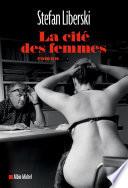
Se retrouver à Cinecittà face à Fellini en plein tournage de La Cité des femmes, jamais Étienne n'aurait osé en rêver. Très vite le jeune homme se lie avec les muses du Maître que ce dernier rudoie, adule ou congédie au gré de ses caprices. Grisé par le climat d'extravagance qui règne sur le plateau, Etienne entame alors une liaison amoureuse avec l'une d'elles, une jeune femme étrange qui jongle avec la séduction, les fantasmes, les mensonges et un déni de la réalité si troublant qu'il va s'y perdre. Plongée dans la vie romaine du début des années 80, le nouveau roman de Stefan Liberski en recrée la magie, les beautés, la démesure, mais aussi les dangers, les ambiguïtés et les perversités.

Le sens est au cœur de l'expérience charnelle, sensuelle, émotionnelle, de la rencontre ; il est dans l'intentionnalité du désir, qui oriente les forces libidinales, et il est aussi dans les productions verbales signifiantes. Comment le corps, dans ses composantes biologiques, et le fonctionnement proprement psychique, contribuent-ils à l'émergence et au développement de ce sens ? Et comment ce dernier organise-t-il, à son tour, les grandes fonctions que sont le rêve, la mémoire, la perception, la représentation, la conscience, le langage ? C'est autour de ces thèmes que dialoguent, dans cet ouvrage, un neurologue et une psychanalyste : ils se fondent, certes, sur deux démarches différentes, mais ils s'appuient aussi sur les traits communs de leur longue expérience clinique respective, et ils acceptent de dépasser les limites de leur discipline propre, pour coopérer réellement, et faire surgir une voie originale d'exploration de la personne humaine, dans son unité psychosomatique.

Pierre Bruno compte pour la psychanalyse. Il n’a cessé d'explorer cette aventure singulière qui devrait être toujours « autre » pour perdurer. Des analystes d'horizons différents débattent de ses contributions relatives à la place que le discours analytique doit faire à la politique (la Cité). En effet, le Discours analytique progresse grâce au travail des psychanalystes qui s'en laissent enseigner. D'où l'intérêt de se lire entre psychanalystes, ou avec d'autres qui s'y intéressent, et d’initier des controverses comme il n'en existe plus dans cette discipline, parfois sclérosée par les pentes institutionnelles et l'entre soi. A partir de cinq ouvrages de Pierre Bruno organisés autour de l’élucidation des problèmes cruciaux de la psychanalyse – fin de l’analyse, passe, père réel,... –, les auteurs extraient une méthode qui s’appuie sur les ressources théoriques de Freud et Lacan et sur la clinique. Se vérifie alors, au-delà des divergences institutionnelles, que la psychanalyse s'adresse à tout un chacun et présente un enjeu politique pour notre temps.

Nous communiquons, souvent follement, par la plainte, la justification, la démonstration, la provocation et la séduction (avoir raison ! ). Nous adhérons sans réflexion à ce qui nous plait dans les propos, les objets, tout ce qui nous attire et nous devient plus-value affichable. La gratification fugace masque les peurs ancestrales, l'héritage des redoutables secrets de famille et le sentiment commun de culpabilité et d'impuissance face à l'étrangeté du monde. Face à l'angoisse de nos limites et de notre finitude il faut cristalliser notre pensée entre espoir et menace sur nos " objets " phobiques ou fétiches. Comme les primitifs qui nous précédèrent, il nous faut alors sacraliser un espace totémique idéalisé et rituel borné de tabous protecteurs. Mais voici la psychanalyse autorisant les jeux du rêve. L'imaginaire peut errer, tracer et énoncer à sa guise combinant à l'infini les idées, les signes et les mots jusqu'à échapper aux normes et aux emprises. Voici naître l'esthétique, l'humour, l'élégance et même le panache. Le mythe infantile de chacun prend sens, s'énonce, peut s'écrire et chasse les vieux fantômes des héritages bornés. Les...

L’importance manifeste prise par la psychanalyse et, successivement, par la psychologie en général, s’explique en grande partie par le statut dont jouit la science moderne après avoir exclu la philosophie du champ des savoirs objectifs, c’est-à-dire fondés sur des preuves rationnelles. Avec cette circonstance aggravante, ici, que la psychanalyse et la psychologie étudient un objet sur lequel la philosophie a, non seulement, son mot à dire, mais encore, est la seule à pouvoir en saisir la véritable nature, puisque l’âme humaine est immatérielle et, de ce fait, échappe à toute méthode purement expérimentale. Rien d’étonnant, par conséquent, si la prétention de la psychanalyse à être autonome en vertu de son préjugé matérialiste aboutit à certaines conclusions irrecevables et désastreuses, en particulier lorsque les notions de responsabilité individuelle, de culpabilité et de devoir moral sont en jeu. Ce sont toutes ces erreurs que ce livre veut expliquer et corriger, ce qui suppose, entre autres choses, qu’on redécouvre la valeur objective, c’est-à-dire véritablement « scientifique », de la philosophie, ainsi que sa capacité à définir ...
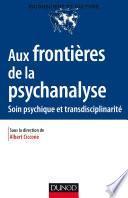
Qu’est-ce qui dans le traitement psychanalytique a des effets de soin ? Deux idées fondamentales sont défendues. La première consiste à dire que la psychanalyse se doit d’être ouverte : aux disciplines connexes qui la « bordent », aux discours autres qui l’interrogent, aux pratiques qui parfois s’y réfèrent mais qui souvent la questionnent. Elle doit accepter et soutenir la contradiction. C’est une condition pour sa survie. La seconde idée est que la marge n’est pas « marginale », mais essentielle. C’est le lieu primordial du soin. Une telle considération ouvre aux dimensions interdisciplinaires et transdisciplinaires, qui seront particulièrement explorées. Cet ouvrage présente une approche psychanalytique mise au service de sujets, de contextes, de problématiques très variées, par des praticiens chevronnés convaincus que la psychanalyse est vivante et utile à tous, notamment à tous ceux qui ne pourront jamais bénéficier des dispositifs classiques. L’ensemble des travaux des co-auteurs s’appuie en particulier et entre autres sur les conceptions de René Kaës, depuis celles relatives aux « formations intermédiaires » jusqu’à celles...

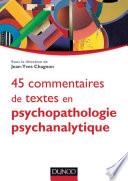
Cet ouvrage commente de manière pédagogique 45 textes "fondamentaux" rédigés par les grands noms de la psychanalyse (Freud, M. Klein, D. Winnicott, S. Lebovici, J. Bergeret, Ph. Jeammet, C. Chabert, etc.), qui ont apporté un éclairage majeur en psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.
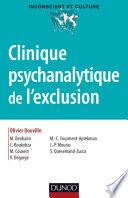
Cet ouvrage est le premier à explorer les diverses facettes des effets subjectifs des exclusions et des précarisations de l’enfance à l’adolescence et à l’âge adulte, et à mettre l’accent sur les réponses institutionnelles et leurs possibles impasses. Ces contributions dans leur ensemble étudient également les fonctions psychiques que peuvent prendre pour certains sujets ces situations de marginalisations extrêmes et de préjudices. Les auteurs ont tous une expérience de terrain confirmée, que ce soit dans le domaine du soin, de la recherche, ou dans l’invention de dispositifs institutionnels ou de l’accompagnement d’équipe. Clinique psychanalytique de l’exclusion s’adresse aux acteurs de soin et d’accompagnement social, à l’heure où les réponses institutionnelles à la précarité tendent dans le domaine du soin à se multiplier au risque d’une certaine dispersion.

La pensée de Lacan est d’une rare difficulté ; ses textes ne sont jamais simples, et son travail s’étend sur une très longue période. Parmi les différentes manières possibles, attrayantes et concurrentes, d’y introduire, ce travail, préférant l’échantillon au panorama, se focalise sur les seuls Ecrits. De ce recueil, si célèbre, Lacan lui-même nous en a proposé sa propre scansion en distinguant trois textes et trois temps : le départ de son enseignement, le redémarrage de sa réflexion, l’achèvement du programme de recherche qu’il s’était à lui-même fixé. Ce livre, très simplement, s’oriente dans le dédale des Ecrits en cherchant à rendre compte de cette triple ponctuation. Ce faisant, il rappelle que la définition de la psychanalyse s’affine d’être distinguée de la science et espère montrer qu’une même grande et lancinante question, volée à la philosophie, habite la pensée lacanienne, à savoir : qu’est-ce qu’un homme ? Et c’est finalement la réponse, superbe, qui se construit patiemment dans les Ecrits que ce travail se propose, pas à pas, de dégager.

Transformation de la place du travail, crise des modèles politiques, individualisme généralisé : les mutations sociales de cette fin de siècle affectent tous les jeunes. Si nombre d’entre eux s’adaptent à ces profonds changements, d’autres expriment leur malaise par des signes de plus en plus visibles qui ont nom violence urbaine, toxicomanie, conduites de fuite... Devant la persistance de ces troubles, faut-il mettre l’accent — et la responsabilité — sur la jeunesse seule ou s’interroger sur le sens des réponses mises en place par les politiques locales en matière de formation, d’accès au travail, de culture et de citoyenneté ? Plutôt que de centrer le débat sur l’énumération des pathologies de la jeunesse et de la considérer comme une éternelle malade, les auteurs proposent d’autres clés de lecture. Un état des lieux de la place effectivement occupée par les jeunes se double d’une prospective des rôles qu’ils pourraient tenir. Entre individualisme et recherche de ritualité, un espace social peut les accueillir et se développer : action humanitaire, cultures plurielles, citoyenneté en sont les ingrédients. Ce livre explore les...

Dans cet HEROS Moment : Manon Giacomini nous relate dans cette publication les recherches menées sur le contre-transfert lors de prises en soins infirmières. Elle a mis en lumière son impact dans la relation soignant-soigné, afin de surpasser les conséquences de ce contre-transfert, pour améliorer les prises en charge.

Que pensent et que veulent les neurosciences cognitives ? (Coord. par Lionel Naccache) Éditorial, par Yves Charles Zarka I - Dossier : Que pensent et que veulent les neurosciences cognitives ?Lionel Naccache, Neurosciences et sciences humaines, une relation à inventer Yves Sarfati, L’électrode et la mémoration. Pour une psychanalyse éclairée des neurosciencesSerge Stoléru, Sommes-nous libres par rapport à nos désirs sexuels ? Une perspective neuroscientifiqueFranck Ramus, Les neurosciences, un épouvantail bien commodeMathias Pessiglione, Décision et rationalité : un sujet indisciplinéJérôme Sackur, Les neurosciences cognitives, ou la science naturelle de l'esprit Approches critiques par Henri Atlan et Jean-Claude Ameisen II - Vie intellectuelleJing Zhao, La question du féminisme en Chine : Une lecture de Simone de Beauvoir III - Vie politiqueLa démocratie : entre déterritorialisation et reterritorialisation
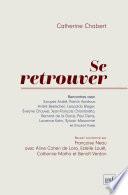
Catherine Chabert associe étroitement les fils d’Œdipe et de la différence des sexes, et ceux de la perte et de la séparation : ils vont venir s’actualiser au plus vif du transfert dans la cure analytique, qui implique l’amour et la haine, l’idéalisation et la déception, l’abandon et le renoncement, mais aussi l’espérance et la conquête d’un peu plus de liberté. Chacune des quatre rencontres dans l’ouvrage privilégie l’un ou l’autre de ces mouvements. Une présentation précise de la thématique précède les textes de chaque auteur qui y revient à sa manière, dans de riches confrontations cliniques et métapsychologiques : Vincent Vivès et Paul Denis dans les « Incertitudes d’Œdipe, commencer avec Flaubert », Leopoldo Bleger, Évelyne Chauvet et Bernard de La Gorce dans « L’un et l’autre », Jacques André, Sylvain Missonnier et Laurence Kahn dans « Mort, meurtre, pulsion de mort », Jean-François Chiantaretto et André Beetschen dans « Aimer la psychanalyse ». Catherine Chabert reprend et prolonge la discussion à la fin de chaque rencontre. Patrick Autréaux en fin de volume livre un poème, Barren Lands.
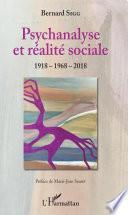
La psychanalyse serait dépassée, dit-on parfois ; et la voici pourtant en pleine expansion vers l'Est ! Ses concepts se retrouvent d'ailleurs dans maints champs scientifiques ou artistiques. Cependant, bien des gens voudraient entreprendre une psychanalyse et ne l'osent ou ne le peuvent pas ; il est vrai que rien n'est fait en France pour leur en faciliter l'accès... Serait-ce toujours le privilège des beaux quartiers ? Nulle histoire de la pratique psychanalytique n'est disponible ; et pourtant, que de projets et de réalisations originales ! Commençant au cabinet de Freud, traversant les premiers instituts et polycliniques, on peut découvrir plusieurs institutions européennes et françaises méconnues. De ce parcours, Bernard Sigg déduit des propositions théoriques qui ébranlent certaines idées reçues, telle " prix " élevé à payer pour qui veut engager une analyse. (1990).
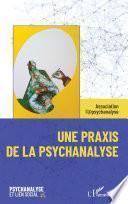
Qu'en est-il d'une praxis de la psychanalyse, du savoir y faire du psychanalyste avec le réel ? Ne relève-t-il pas d'un work in progress, qui exige de remettre sans cesse sur le métier la question que François Tosquelles nous a laissée en héritage : « Et toi qu'est-ce que tu fous là ? ». Cet ouvrage écrit à plusieurs mains surgit à un moment d'effacement de l'humain, ce via une mise au pas sans précédent scientifico-étatique, managériale et marchande, de l'ensemble des métiers et des praxis historiques et traditionnelles s'y afférant. Les protestations des psychologues, des soignants, des travailleurs sociaux, des chercheurs, des enseignants, des policiers, des magistrats et de bien d'autres catégories de personnels voués à l'impossible, oeuvrant dans le champ social, en attestent. L'impossible c'est bien le réel tel que Freud le fait figurer dans ces trois praxis du soigner, de l'éduquer et du gouverner.
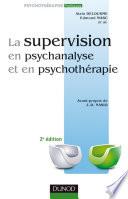
Tous les psychanalystes et les psychothérapeutes sont tenus de passer par une supervision nécessaire pour la validation de leur profession. D'ou cet ouvrage qui associe les meilleurs noms de la psychanalyse (Nasio, Gillieron, Pinel...) et des psychothérapies (Ginger et Robine pour la Gestalt, Rubbers pour l'AT...) pour proposer un inventaire didactique des cadres et des pratiques. Les auteurs ont revu et corrigé leurs textes à l'occasion de cette nouvelle édition .

On connaît Gérard Guégan comme auteur (plus de vingt romans et récits, dont, chez Grasset, La Rage au coeur, Soudain, l'amour, Les cannibales n'ont pas de cimetières), comme traducteur (en particulier de Bukowski, dont il fut aussi l'éditeur), comme critique. On se souvient qu'il fut de 1975 à 1979 le directeur des Editions du Sagittaire, alors relancées par Grasset, et qu'il s'y entoura de Raphaël Sorin, d'Olivier Cohen et du graphiste Alain Le Saux. On sait moins qu'il créa, avec Gérard Lebovici, impresario mythique, fondateur d'Art Media assassiné en 1984, les Editions Champ Libre, dont il fut durant sept ans le directeur littéraire. Dans la veine d'Un cavalier à la mer, d'Inflammables et d'Ascendant Sagittaire, ce livre est le premier volet d'une aventure singulière, qui débute avec la rencontre de Gérard Lebovici sur les quais de la Seine une nuit de mai 1968 et s'achève sur la rupture avec le même, Floriana Lebovici et Guy Debord au début de l'année 1975. Le présent volume retrace les trois premières années des Editions Champ libre (1969-1971) dans le Paris du préfet Marcellin et la France de Pompidou. On y assiste à la naissance d'une amitié...

Etude approfondie de la notion scientifique d'information. La notion d’information est particulièrement polymorphe, luxuriante même. Ses définitions prolifèrent, son domaine lexical est si vaste que la probabilité que deux spécialistes de l’information (sans plus de précision) évoquant cette notion ne parlent en fait pas de la même chose est très élevée. Nous avons tous une idée vague et courante de que ce terme veut dire, nous utilisons tous ce vocable aux multiples acceptions propres à notre quotidien, tandis que les physiciens et les mathématiciens, entre tentatives de formalisation rigoureuses et multiplications des domaines d’application de l’information, développent sans cesse leur compréhension de ce que certains voient comme une nouvelle catégorie du réel. Les sciences humaines, via notamment les sciences de l’information et de la communication, et la linguistique, ont également contribué à l’inflation conceptuelle et lexicale des usages et significations de ce terme. Quant à la biologie, il est patent qu’elle a incorporé l’information à son socle théorique de manière massive. Cette discipline est sans doute celle où cette notion ...

Au travers de l'étude de la psychomotricité, cet ouvrage se livre à une double analyse, à la fois épistémologique et socioprofessionnelle, concernant la psychologie clinique. La tension qu'éprouvent les psychomotriciens à l'égard de la fonction de psychothérapeute, leur dépendance statutaire au médical, la référence fascinée mais peu rigoureuse aux théories psychanalytiques exemplifient une triple césure, celle entre clinicien et psychanalyste, celle entre praticien et universitaire, celle entre technicien et responsable institutionnel.

En suivant les chemins parcourus par son expérience des lieux de l’analyse, l’auteur, qui se refuse à rédiger un traité d’éthique analytique et pour qui la morale n’ouvre pas de portes freudiennes, rencontre des situations vivantes dans lesquelles, le plus souvent, pour demeurer créatif, il côtoie les limites de ce qu’il pense être autorisé. En d’autres termes, il explore les conséquences de la vie amoureuse pour la pensée de l’analyse et la pensée tout court. On sait, depuis Freud et sa référence à saint Paul, que « si [on n’a] pas l’amour [...] », on n’est que bruit et vent. La pensée est en effet une matière amoureuse, sexuelle, dense, irriguée par la libido, et soumise aux déviations. Question : le psychanalyste peut-il évaluer les problèmes éthiques – théoriques comme pratiques – avec une pensée dont la source est « perverse polymorphe » ? Réponse : oui.

Depuis le tournant libéral des années 1990, les psychothérapies sont en plein essor dans la société indienne. Ce livre, consacré au cas particulier de la psychanalyse à Delhi, décrit la façon dont cette nouvelle pratique s’insère dans les modes de vie. Pourquoi la thérapie devient-elle une pratique de plus en plus répandue ? À quel besoin cela répond-il ? Comment les structures sociales du monde indien imprègnent-elle la thérapie et quelles sont les particularités de la thérapie à l’indienne, par comparaison avec ses autres déclinaisons (européennes ou nord-américaines notamment) ? À partir d’une riche ethnographie et de nombreuses études de cas, Anne Gagnant de Weck montre en quoi l’expérience contemporaine de la thérapie reflète les tensions occasionnées par la progression – très contestée – des valeurs individualistes (d’autonomie, de choix et de bonheur personnel) dans une société de castes réputée pour sanctifier le groupe et dénier toute valeur à l’individu. En articulant ainsi une question sur le sens de la thérapie dans des vies individuelles avec une question sur la forme de son dispositif, l’autrice offre une...
Plus d'informations