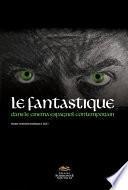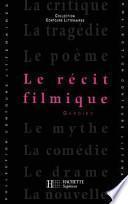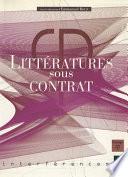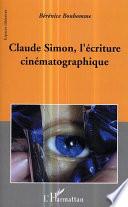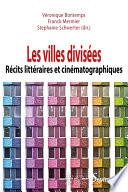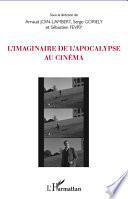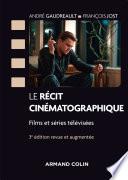
Le récit cinématographique - 3e éd.
Auteure: André Gaudreault , François Jost
Nombre de pages: 224Rédigé par deux pionniers de la narratologie du cinéma, Le Récit cinématographique est devenu, depuis sa première édition en 1990, un classique reconnu pour sa clarté. Véritable manuel d’introduction, mais aussi ouvrage de synthèse particulièrement précieux, il se destine aux enseignants et aux étudiants en cinéma et en communication, ainsi qu’à tous ceux qui veulent comprendre les concepts et les mécanismes du récit : la narration, l’espace, la temporalité et le point de vue. À l’occasion de cette troisième édition revue et augmentée, les références cinématographiques ont été actualisées, l’étude du récit a été étendue aux séries télévisées et des analyses de séquences de films et de séries ont été ajoutées pour illustrer l’usage que l’on peut faire des concepts. « [...] rarement on aura vu autant de clarté et de concision dans un ouvrage traitant de narratologie et de cinéma. [...] Parce qu’on ne se lasse pas d’un discours conjuguant limpidité et intelligence et parce qu’un bon ouvrage de synthèse manquait cruellement aux écrits sur la narratologie, voilà un petit essai auquel on reviendra souvent » (Marcel...