
Trouver votre ebook...

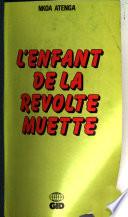
L'enfant de la révolte muette
Auteure: Nkoa Atenga
Nombre de pages: 170
La littérature camerounaise depuis l'époque coloniale
Auteure: Marcelin Vounda Etoa
Nombre de pages: 286
Annales de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Ngaoundéré
Auteure: Université De Ngaoundéré. Faculté Des Arts, Lettres Et Sciences Humaines

Calixthe Beyala
Auteure: Charles Salé
Nombre de pages: 133
Calixthe Beyala
Auteure: Charles Sale
Nombre de pages: 142Charles Salé procède à l'autopsie des structures narratives de l'oeuvre et du sens qui découle de l'architecture formelle du roman. Il opte pour le décodage des aspects de l'écriture de Beyala qui est essentiellement dissidente et iconoclaste. Avec une indéniable rigueur scientifique, il dévoile le parti-pris contestataire de l'oeuvre sur les normes du roman classique.

Anthologie de la littérature camerounaise
Auteure: Bruno Essard-budail , Jean-ferdinand Tchoutouo , Fernando D' Almeida
Nombre de pages: 324
Mondes francophones
Auteure: Association Pour La Diffusion De La Pensée Française
Nombre de pages: 748Littérature et sciences humaines en Suisse romande depuis 1990 / Robert Kopp (p. 499-505) suivie d'une bibliographie analytique d'oeuvres littéraires encore disponibles d'auteurs romands et parmi eux de nombreux vaudois (p. 507-530); suivi par des essais en sciences-humaines (p. 531-547).

Les enfants de la transition
Auteure: Luc Ndjodo
Nombre de pages: 226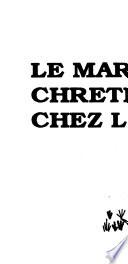
Le mariage chretien chez les Beti
Auteure: Luc Ndjodo
Nombre de pages: 84
Nouvelles études francophones

Jalousies de femme et complicités coupables
Auteure: Camille Nkoa Atenga
Nombre de pages: 274Le roman plante d'entrée le décor à Yaoundé : Yaoundé d'hier, Yaoundé d'aujourd'hui. Laetitia, d'origine béti, est pharmacienne ; André, avocat d'affaires, se réclame du pays bamiléké. Le coup de foudre et le coup de coeur partagés et conclus entre eux lors d'un inoubliable voyage en avion entre Paris et Douala a tourné au désarroi...
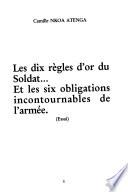
Les dix règles d'or du soldat-- et les six obligations incontournables de l'armée
Auteure: Nkoa Atenga
Nombre de pages: 148
Notre librairie

Malinda
Auteure: Nkoa Atenga
Nombre de pages: 214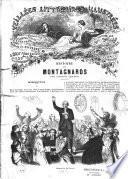
Histoire des Montagnards
Auteure: Alphonse Esquiros
Nombre de pages: 114
Les romans illustrés, anciens et modernes
Nombre de pages: 306
La guerre des poules
Auteure: Stéphane Sénégas , Frédéric Maupomé
Nombre de pages: 32Anuki, le petit Indien, s’ennuie ferme : il n’y a décidément rien à faire au village. Et voilà qu’au moment exact où il trouve enfin à tromper son ennui en s’amusant avec un grigri que lui a donné sa maman, les problèmes commencent... avec une bande de poules !
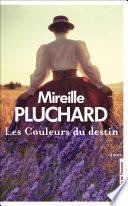
Les Couleurs du destin
Auteure: Mireille Pluchard
Nombre de pages: 570Au XIX e siècle. De son village cévenol de Saint-Martial au soleil d'Avignon, le destin romanesque de Sixtine, qui va se révéler grâce à l'amour inconditionnel de son mari indienneur. Mais aussi par un puissant désir de revanche sur son passé, et sa quête de vérité quant à ses origines. Juin 1813. Fuyant le mépris, une jeune fille chemine seule sur les routes, sous une autre identité... Non loin de ce Rhône qui la fascine, c'est dans une Provence pleine de couleurs que Sixtine trouve refuge. Un riche manufacturier en indiennes, subjugué par son regard d'azur, conquis par son don pour le dessin, fait bientôt d'elle son épouse. Malgré leur différence d'âge, et le passé de la jeune fille... Des années plus tard, devenue une femme respectée, à la tête des ateliers de la manufacture de son mari, Sixtine décide de revenir dans ses Cévennes natales. Afin de prendre sa revanche sur les riches propriétaires du Souleiadou, elle qui, naïve, s'était imaginée au bras de leur fils héritier ? Afin de faire aussi toute la lumière sur les ombres de son enfance malaimée ? Dans un Sud plein de contrastes, un grand destin romanesque.

L'effet de vie
Auteure: Marc-mathieu Münch
Nombre de pages: 408
Les luttes religieuses en France au XVI siècle
Auteure: Camille Meaux
Nombre de pages: 500
Les luttes religieuses en France au seizième siècle
Auteure: Marie Camille Alfred Vicomte De Meaux
Nombre de pages: 415
Les luttes religieuses en France au seizième siècle
Auteure: Mario Camille Albert Vicomte De Meaux
Nombre de pages: 415
Les luttes religieuses en France au seizième siècle
Auteure: Camille De Meaux
Nombre de pages: 500
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle
Auteure: Pierre Larousse
Nombre de pages: 1550
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique,....
Auteure: Pierre Larousse
Nombre de pages: 1542
La Revue hebdomadaire
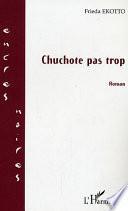
Chuchote pas trop
Auteure: Frieda Ekotto
Nombre de pages: 156"Les jeunes filles de Fulani sont enfermées ainsi, parfois pendant des années, dans l'obscurité, jusqu'à leur mariage imposé." A travers des portraits de femmes aux destins rebelles, de conflits de cultures, Frieda Ekotto bouscule les préjugés pour nous proposer une autre vision des rapports humains. Riche de son écriture composite, éclaté, ce récit échappe ainsi aux formes traditionnelles de la narration.

La Revue du cinéma
Nombre de pages: 592
Poésies ...
Auteure: Académie Des Muses Santones, Royan

Quatre-vingt-treize
Auteure: Victor Hugo
Nombre de pages: 188
Oeuvres complètes de Bossuet
Auteure: Jacques Bénigne Bossuet
Nombre de pages: 702
L'Enfant idiot
Auteure: Claude Delarue
Nombre de pages: 271Ce livre n'est pas une biographie exhaustive ; il n'est pas non plus un essai universitaire. Parmi la production, considérable, d'ouvrages consacrés à l'auteur des Fleurs du Mal, il se situe en deçà, dans ce champ expérimental où déambulent volontiers les écrivains, et que Baudelaire, lui-même, appelait, à propos de son étude sur Edgar Poe, la critique d'identification. En août 1844, le poète a 23 ans. Depuis sa majorité, il est en possession d'une somme rondelette. En deux ans, il en dépense somptuairement la moitié. Sa famille décide alors, pour sauver ce débauché, de le mettre sous tutelle judiciaire. Désormais, chacune de ses dépenses devra être comptabilisée. L'argent, obsession baudelairienne... Cette tutelle qui le relègue au rang d'enfant, Baudelaire en subira la honte sa vie durant. Honte à multiples facettes, qui sera responsable de sa conduite d'échec, de ses provocations, comme de ce qu'il appelait son guignon. Mais honte aussi qui attisera, chez le poète, une tendance naturelle à la révolte. La révolte sera l'héroïsme de Baudelaire. Elle lui donnera la force de poursuivre son œuvre et fera de lui, malgré une terrible succession...

Le magasin littéraire

La Saison cinématographique
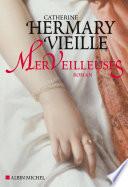
Merveilleuses
Auteure: Catherine Hermary-vieille
Nombre de pages: 432Les grands destins de femmes passionnent depuis toujours la romancière et historienne Catherine Hermary-Vieille. Merveilleuses retrace le parcours des égéries de cette brève période qui suit la Terreur, où une fureur de divertissements et d’excès enfièvre Paris. On rit, on danse, on aime, on revit : jouissance et plaisirs sont les nouveaux mots d’ordre. Femmes d’esprit, frivoles et charmantes, Thérésia Cabarrus et Rose de Beauharnais sont les plus merveilleuses d’entre ces Merveilleuses, qui profitent de la liberté retrouvée : elles collectionnent les amants comme d’autres les chapeaux, lancent les modes les plus provocantes et mènent par le bout du nez les hommes au pouvoir. Thérésia épouse Tallien pour devenir la maîtresse de Barras, quitté par Rose pour Bonaparte, un obscur petit général corse qui l’aime à la folie, en partance pour l’Egypte. Il en reviendra premier Consul, exigeant de celle qu’il appelle désormais Joséphine qu’elle rompe avec son passé tumultueux. Le temps des Merveilleuses a vécu ! Amours, ambitions, secrets d’alcôves, conspirations..., Catherine Hermary-Vieille restitue avec tout son talent romanesque et sa...

Le Ménestrel

Quatrevingt-treize
Auteure: Victor Hugo
Nombre de pages: 472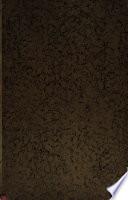
Le Constitutionnel
Nombre de pages: 516Journal du commerce, de politique et de littérature
Plus d'informations