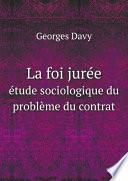
La foi jur?e
Auteure: G. Davy
La formation du lien contractuel
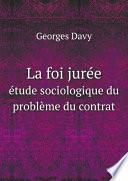
La formation du lien contractuel






Dans cet ouvrage posthume, Alain Testart s'attache à poser les bases d'une sociologie générale permettant de classer les sociétés les plus diverses et de penser leur évolution au-delà des champs disciplinaires établis (ethnologie, histoire, sociologie). C'est par la relecture de Tocqueville, Marx et Durkheim, qui n'avaient pas hésité à chercher la cohérence interne des sociétés et à en dégager en quelque sorte des types sociaux, qu'il commence par préciser sa méthodologie. Celle-ci consiste à définir l'" architectonique d'une société ", c'est-à-dire les " rapports sociaux fondamentaux " conditionnant les autres rapports et permettant d'expliquer les domaines du politique, de l'économie et du religieux. Pour montrer que ces " rapports sociaux fondamentaux " relèvent d'une forme de dépendance ou au contraire d'indépendance, l'auteur étudie trois types de société : les Aborigènes d'Australie, la société féodale et la société moderne. Il élargit ensuite son examen tant aux civilisations classiques qu'aux sociétés sans État, et souligne par exemple combien la liberté des " modernes " n'est pas celle des Grecs, ni celle des Amérindiens. Alain...





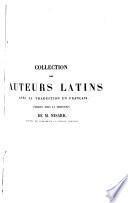



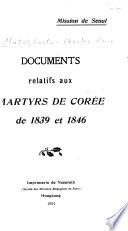

Cet ouvrage est consacré à l’étude de l’aveu dans les traditions pénales occidentales accusatoire et inquisitoire depuis le pré-droit grec jusqu’à nos jours. Avant d’être une règle de preuve et de devenir une pièce autonome de procédure, l’aveu a d’abord été un outil exploratoire de l’individu en philosophie avant que la religion s’en empare comme un dispositif de contrôle des âmes. L’aveu juridique a donc été précédé d’un aveu moral dont il ne s’est jamais vraiment départi. Bien qu’ils partagent des racines communes, les systèmes accusatoire et inquisitoire ont établi des règles différentes à son égard. Dans la procédure accusatoire, issue de la tradition de common law, l’aveu poursuit certes un objectif de vérité à l’instar de la procédure inquisitoire. Mais, contrairement à cette dernière, il a dû répondre très tôt à un impératif de fiabilité, conduisant à la création de règles de preuve et de procédure qui ont ainsi permis de limiter, du moins en apparence, sa fonction politique. Cette différence de traitement de l’aveu dans les deux systèmes ne peut se comprendre que dans le cadre d’un récit...

Le Classcompilé n° 110 contient les oeuvres de Tite Live soit la totalité de l'Histoire Romaine qui est arrivée jusqu'à nous. Traduction essentiellement sous la direction de M. Nisard, 1839. La mise à jour du texte de 1839 est assurée par des notes et de légères corrections. Tite-Live (en latin : Titus Livius), né vers 59 av. J.-C. (premier siècle av. J.-C.) et mort en 17 ap. J.-C. (premier siècle ap. J.-C.) dans sa ville natale de Padoue (Paduvium en latin), est un historien de la Rome antique, auteur de la monumentale œuvre de l'Histoire romaine (Ab Urbe condita libri (AUC)). (Wikip.) AVIS DES ÉDITEURS NOTICE SUR TITE-LIVE. PRÉFACE LIVRE I - Des origines lointaines à la fin de la royauté (jusqu’en 509 av. J.-C.) LIVRE II - Les débuts de la République (509 à 468 av. J.-C.) LIVRE III - Les décemvirats (468 à 446 av. J.-C.) LIVRE IV - La croissance des pouvoirs de la plèbe (445 à 404 av. J.-C.) LIVRE V - La prise de Véies et sac de Rome par les Gaulois (403 à 390 av. J.-C.) LIVRE VI - Reconstruction de Rome et victoires de la plèbe (389 à 367 av. J.-C.) LIVRE VII - Guerres latines et samnites (366 à 342 av. J.-C.) LIVRE VIII - Guerres latines et...
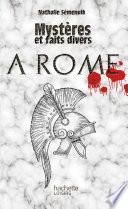
Combats de gladiateurs truqués, complots sanglants, poisons violents... 20 nouvelles énigmes policières, toutes l'occasion pour le lecteur d'endosser les habits de l'enquêteur et de mettre sa perspicacité au service de l'empereur. À lui de trouver le coupable !
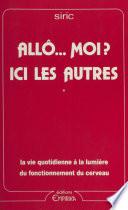
Journellement, nous communiquons les uns avec les autres. Dialogue de sourds : les priorités de l’un paraissent accessoires à l’autre. On se marie et, quelques années plus tard, on découvre qu’on ne se comprend pas, qu’au fond, on ne s’est jamais compris. Ainsi, nous vivons les uns à côté des autres, comme des mondes étrangers qui ne se rejoignent pas. Pourquoi ? D’autre part, chacun de nous, sans même le vouloir, a tendance à apporter toujours le même type de réponse aux circonstances les plus diverses de la vie. Des stéréotypes inadaptés. Comment se fait-il que chacun retombe ainsi dans les mêmes ornières... même quand ses intérêts sont en jeu... et malgré des trésors de bonne volonté ? Cet ouvrage tente de répondre à ces difficultés quotidiennes. Au terme d’une recherche approfondie, s’appuyant sur de nombreuses observations, comme sur les données les plus récentes de la neuro-physiologie, les auteurs sont arrivés au constat suivant : contrairement à ce qu’on pourrait croire, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, mais les individus se regroupent en plusieurs grandes familles de sensibilités différentes. De l’un...

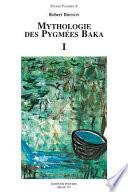
Ici, se trouvent presentees la mythologie et les croyances des Baka. L'auteur a recueilli, au cours de longues annees de sejour parmi eux, l'expression de leurs traditions dans ce domaine d'acces difficile. La mythologie (vol. 1) est developpee dans un ordre relativement chronologique, du moins pour la presentation des entites qui la composent, d'apres les entretiens avec des anciens dont les paroles sont fidelement rapportees. Son intemporalite apparait des le premier abord. Les demiurges primordiaux, Komba et son neveu uterin Waito, ne sont pas des createurs, mais des organisateurs d'une creation fondamentale preexistante. Komba faconne, a partir d'une prehumanite, l'ensemble des etres vivants, animaux et vegetaux. Detenteur de tous les biens vitaux, comme l'eau, le feu ... et des connaissances, c'est Waito, heros civilisateur et pere des humains, qui les lui derobe pour en faire profiter les hommes. Les contes (vol. 1 et 2) sont en fait des mythes d'origine et des contes explicatifs, rationalisant les mysteres de la nature et projetant dans l'imaginaire collectif l'organisation traditionnelle de la societe. Ils vehiculent les grands principes moraux qui regissent l'univers...


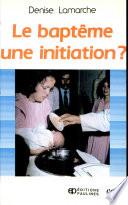
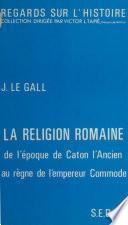
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
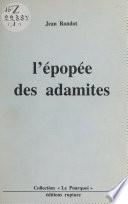
Les hominiens des temps paléolithiques s’acharnèrent — pendant des centaines de millénaires — à perfectionner la taille de leurs outils. Nous-mêmes, hommes du XXe siècle, avons mis vingt-cinq siècles à construire une science fondée sur la seule raison. Ces considérations nous portent à croire que tout progrès humain est l’effet d’un persévérant labeur, et de l’accumulation des découvertes faites par les générations antérieures. Pourtant, c’est tout à coup — et apparemment sans effort — qu’ « Homo Sapiens » acquiert l’art de peindre. Et la civilisation sumérienne naît sans que des générations d’astronomes aient — d’abord — observé les étoiles, et noté les particularités de leur marche. La langue sumérienne elle-même, que l’on tient pour la plus belle qui ait jamais été parlée, d’où nous vient-elle, puisque ses racines ne se trouvent dans aucune des langues antérieures ? Alors, faut-il considérer que le progrès de l’humanité n’est pas — nécessairement — l’effet du seul labeur de l’homme, mais peut aussi provenir de dons gratuits « tombés du ciel ». Ne convient-il pas, par exemple, d’imaginer...



![Voyages d'Antenor en Grece et en Asie, avec des notions sur l'Egypte; manuscrit grec trouvé a Herculanum, traduit par E. F. Lantier. ... Avec cinq planches. Tome premier [-cinquieme]](https://cdn1.ebooks-gratuits.club/images/libro/voyages-d-antenor-en-grece-et-en-asie-avec-des-notions-sur-l-egypte-manuscrit-grec-trouve-a-herculanum-traduit-par-e-f-lantier-avec-cinq-planches-tome-premier-cinquieme-id-_-O1sTxu_n8C.jpg)
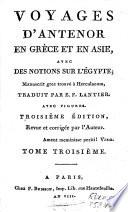
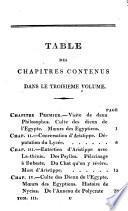



Source de pouvoir et d’énergie, les rites sexuels et de mariage rythment le cycle de vie des Négro-Africains. De fait, en Afrique noire, une sexualité équilibrée, c’est le lit d’un mariage stable et fécond. Une sexualité non épanouie s’avère même désastreuse, tant pour l’individu que pour la société. Mais si le sexe et le mariage situent l’être humain dans le voisinage immédiat du divin et des ancêtres, leur accès exige beaucoup de temps et de peine. Aussi l’originalité des coutumes négro-africaines est-elle de placer, au moment du passage de l’enfance à la vie d’adulte, un enseignement spécial pour une vie harmonieuse du couple et contre les dangers du libertinage sexuel, réponse aux jeunes dans leur soif d’exploration, d’intensité et d’intériorité. À l’heure où les mœurs occidentales phagocytent nombre de cultures, dans un monde où les liens matrimoniaux tendent à se défaire ou à être minimisés, Emmanuel Vangu Vangu offre ici un décryptage des coutumes qui entourent mariage et sexualité en Afrique noire, et plus précisément dans les sociétés bantu. Au creux d’une réflexion située à mi-chemin entre le...
![Bibliothèque latine-française publiée par C. L. P. Panckoucke. [1st, 2d Series.] Lat.&Fr](https://cdn1.ebooks-gratuits.club/images/libro/bibliotheque-latine-francaise-publiee-par-c-l-p-panckoucke-1st-2d-series-lat-fr-id-pkRP8n_icx4C.jpg)


Plus d'informations