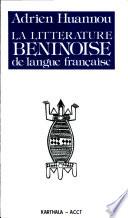
Trouver votre ebook...
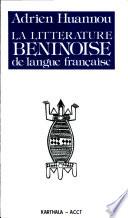

L'arbre fétiche de Makassi
Auteure: Alabassa Worou
Nombre de pages: 315
Le roman ouest-africain de langue française
Auteure: Albert Gandonou
Nombre de pages: 357On pourrait dire qu'il se développe, depuis les années 1960 et singulièrement ces dernières années, un véritable mythe au sujet de la littérature de langue française produite par des Africains. Celle-ci serait " africaine ", c'est-à-dire qu'elle n'aurait rien à voir avec la littérature française, et pour l'expliquer il faudrait forcément recourir à la tradition orale africaine. Cette idée nous paraît désastreuse au plan pédagogique puisqu'elle conduit à donner aux élèves et aux étudiants une vue étriquée et tronquée de la réalité et de l'histoire de la littérature africaine de langue française. On pourrait affirmer au contraire que la littérature de langue française ayant pour thème l'Afrique et ses hommes, si elle est africaine, l'est autant sous la plume des écrivains blancs que sous celle des écrivains noirs. Mais, cette étude de langue et de style paraît démontrer amplement qu'il ne s'agirait, ni plus ni moins que de littérature française. L'ouvrage tente de redéfinir la littérature francophone négro-africaine sur des critères autres que ceux de l'idéologie et de la race. La grammaire, l'étude attentive du lexique et de la syntaxe,...

Les mots du patrimoine
Auteure: Geneviève N'diaye-correard
Nombre de pages: 600Malgré le dynamisme du wolof dans les villes et les tentatives de promotion des autres langues locales, le français, au Sénégal, demeure très présent, notamment dans la vie publique, dans la vie culturelle, dans la presse. Il est illustré par une littérature de qualité, la plus ancienne et l'une des plus abondantes des littératures francophones d'Afrique subsaharienne. Appris le plus souvent à l'école, le français n'a pas connu au Sénégal, malgré quelques innovations grammaticales mineures, la pidginisation qui a conduit, en Côte d'Ivoire, par exemple, à l'émergence d'un " français populaire ". En revanche, son lexique s'est considérablement enrichi de termes désignant des réalités locales aussi bien que d'emprunts et de calques issus des langues locales, ou encore de libres créations qui témoignent d'un véritable processus d'appropriation par les francophones sénégalais de cette langue venue d'ailleurs. L'équipe de chercheurs de l'Université de Dakar dirigée par le professeur Geneviève N'Diaye-Corréard s'est attachée à collecter, analyser et illustrer d'exemples écrits et oraux authentiques des centaines de mots et expressions qui façonnent,...

DICTIONNAIRE DES OEUVRES LITTÉRAIRES DE LANGUE FRANÇAISE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA
Auteure: Ambroise Kom
Nombre de pages: 670En traitant, à la fois de la rupture du concubinage classique et de celle du PACS, l'ouvrage non seulement comble une lacune, mais aussi, pour la première fois, étudie ce que seront les futures désunions des " pacsés ". En abordant le concubinage, sous son angle le plus caractéristique, il s'attaque aux idées reçues d'une assimilation entre union libre et union instituée. L'auteur démontre pourquoi la liberté de rompre doit être réaffirmée, quels sont les fondements théoriques et ses conséquences concrètes, et propose une solution nouvelle aux problèmes résultant de la nécessité de partager l'actif commun et d'assurer une juste participation de chacun à l'enrichissement collectif.
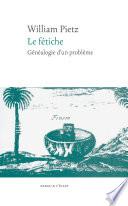
Le fétiche
Auteure: William Pietz
Nombre de pages: 162" Fétiche " est un terme dont la réputation est depuis toujours entachée. Avant que le XIXe siècle ne se l'approprie (fétichisme des marchandises chez Marx, sexuel chez Freud), le fétiche a une histoire linguistique et théorique singulière dont l'origine se trouve dans le brassage multiculturel des cotes de l'Afrique de l'Ouest aux XVe et XVIe siècles, lorsque les marchands portugais (puis hollandais) arrivent en Guinée et se confrontent à des systèmes de valeurs économiques et religieux différents des catégories européennes. En remontant aux racines de l'Église catholique, qui très tôt se posa le problème de l'idolâtrie, William Pietz retrace la généalogie du " fétiche " et dévoile la complexe histoire d'une problématique qui pendant longtemps a concerné, de manières diverses, la pérennité des échanges économiques, le pouvoir de l'image idolâtrée, des pratiques de sorcellerie, l'incarnation du divin, les théories sur les religions primitives... Du latin factitius au pidgin fetisso, de Tertullien et saint Augustin aux Lumières, ce livre montre toute la complexité de cette " idée-problème " qui a participé aux fondements des sciences humaines.
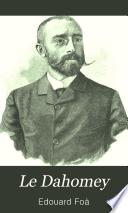
Le Dahomey
Auteure: Edouard Foà
Nombre de pages: 502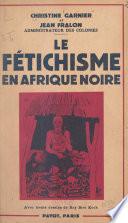
Le fétichisme en Afrique noire
Auteure: Jean Fralon , Christine Garnier
Nombre de pages: 232Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.

Dictionnaire de la fable
Auteure: François Noel
Nombre de pages: 880
Revue scientifique

Histoire générale des voyages ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues ... avec les moeurs des habitans ...
Nombre de pages: 752
Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues: contenant ...
Auteure: John Green
Nombre de pages: 764
Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages ... qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues
Nombre de pages: 766
Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont ete publiees jusq'a present dans les differentes langues de toutes les nations connues: ... pour former un sisteme complet d'histoire et de geographie moderne ... enrichi de cartes geographique ... de plans et de perspectives; ... Tome premiere -vingtieme
Nombre de pages: 660
Histoire generale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre
Auteure: Jacques-philibert Rousselot De Surgy

Mémoires de l'Académie nationale de Metz
Auteure: Académie Nationale De Metz
Nombre de pages: 692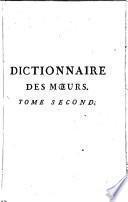
Dictionnaire Universel, Historique Et Critique Des Moeurs, Loix, Usages & Coutumes Civiles, Militaires & Politiques & des Cérémonies & Pratiques Religieuses & Superstitieuses, tant anciennes que modernes, des Peuples des quatre Parties du Monde
Nombre de pages: 530![Dictionnaire de la fable, ou mythologie grecque, latine, egyptienne, celtique ... Tome premier [- second]](https://cdn1.ebooks-gratuits.club/images/libro/dictionnaire-de-la-fable-ou-mythologie-grecque-latine-egyptienne-celtique-tome-premier-second-id-YoOQIsELkSoC.jpg)
Dictionnaire de la fable, ou mythologie grecque, latine, egyptienne, celtique ... Tome premier [- second]

Dictionnaire de la fable, ou mythologie grecque, latine, egyptienne, celtique ... Tome premier [- second!par Fr. Noel ...

Dictionnaire de la fable, ou, Mythologie grecque, latine, egyptienne, celtique, persane, syriaque, indienne, chinoise, mahométane, rabbinique, slavonne, scandinave, africaine, américaine, iconologique, etc
Auteure: François Joseph Michel Noël
Nombre de pages: 822
Dictionnaire de la fable, ou Mythologie grecque, latine, égyptienne, celtique...
Auteure: François-joseph-michel Noël
Nombre de pages: 818
Dictionnaire de la fable
Auteure: François Joseph Michel Noël
Nombre de pages: 782
Histoire générale des voyages, ou: Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre

Dictionnaire universel, historique et critique des moeurs, loix, usages et coutumes civiles, militaires et politiques ...
Auteure: Jean-pierre Costard

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle
Auteure: Pierre Larousse
Nombre de pages: 1696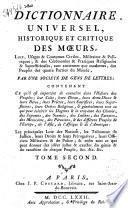
Dictionnaire universel, historique et critique des moeurs, usages et coutumes civiles, militaires et politiques, religieuses et superstitieuses, tant anciennes que modernes, des peuples des quatre parties du monde... par une société de gens de lettres
Nombre de pages: 514
HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES, OU NOUVELLE COLLECTION DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES PAR MER ET PAR TERRE
Auteure: John Green

Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique....
Auteure: Pierre Larousse
Nombre de pages: 1664
Mémoires de l'Académie de Metz
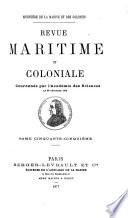
Revue maritime et coloniale

La Revue maritime

Histoire generale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre (etc.)
Auteure: Antoine Francois Prevost D'exiles
Plus d'informations