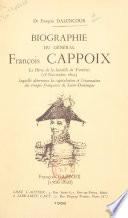
Biographie du général François Cappoix
Auteure: François Dalencour
Nombre de pages: 240Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
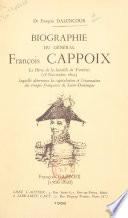
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.

Pendant la domination espagnole en Amérique Latine du xvie au xixe siècle, l'Espagne était, en tant que métropole, l'interlocutrice naturelle des autres nations européennes. Tout ce qui était lié à l'itinéraire Europe-Amérique hispanique passait par la couronne espagnole, ou du moins c'est ce qu'elle prétendait : les idées, les arts, les institutions, les marchandises, les nouvelles, les voyageurs, etc. Cependant, après les guerres d'indépendance qui eurent heu au début du xixe siècle et qui furent la conséquence directe de l'affaiblissement de la monarchie espagnole après l'invasion du pays par les troupes de Napoléon Ier, les pays libérés du joug espagnol établirent de nouvelles relations avec l'Europe, fixant leurs propres règles et laissant voir leurs préférences pour certaines nations européennes.

La Caraïbe, région fondatrice du regard européen sur le Nouveau Monde, a été pendant plusieurs siècles l'un des lieux d'expérimentation de l'esclavagisme moderne en tant que point d'aboutissement de la traite atlantique. Espace insulaire à l'hétérogénéité sans cesse remaniée, aussi bien au plan des mélanges et métissages de populations autochtones ou " importées " (esclaves noirs d'Afrique évidemment mais aussi travailleurs asiatiques sous contrat ultérieurement) qu'à celui des éléments économiques, sociaux, culturels, religieux et linguistiques des sociétés, la Caraïbe reste encore largement méconnues des lecteurs français en sciences sociales et historiques. La présence de trois sur quatre des départements d'outre mer (Guyane, Guadeloupe et Martinique) dans cette partie du monde n'a malheureusement, et paradoxalement, que peu contribué à améliorer cette connaissance. Cette anthologie ne peut combler à elle-seule cette lacune, d'autant qu'elle ne concerne que les approches historiques (même si certains auteurs sont plutôt anthropologues). Qualifiée par les éditeurs de ce recueil de " frontière coloniale ultime de l'Occident et des pays du...
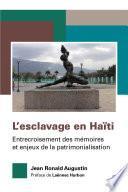
Les mémoires de l’esclavage sont présentes et continuellement réactualisées en Haïti. Elles sont caractérisées par l’invisibilité des lieux qui les supportent, l’invisibilité de la résistance culturelle et l’invisibilité des conséquences sociales de l’esclavage (la pauvreté, les inégalités). Leur patrimonialisation dépasse le cadre normatif de mise en valeur dans les musées, de création de parcs et de construction de mémorial. Elle dépend des expériences historiques, sociales et culturelles qui sont transmises. Cet ouvrage met à nu la distorsion entre la mémoire élaborée sur le plan étatique et le travail de mémoire non élaboré réalisé par la population. Après plus de deux siècles d’indépendance d’Haïti, il convient de chercher à comprendre ce qui a marqué, ce qui a été transmis, conservé, rejeté, refoulé, ce qui est mobilisable et mobilisé, dans quelles circonstances et avec quels objectifs. Aujourd’hui, où se situent le souvenir de la souffrance de l’esclavage et l’orgueil d’en avoir triomphé?



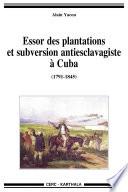
Lorsque lui parvint à Madrid où il se trouvait la nouvelle des débuts en 1791 de la révolution nègre dans la partie française de Saint-Domingue, Francisco de Arango y Parrerio qui fut l'oracle de la plantocratie cubaine comprit que l'heure de la félicité avait sonné pour les siens. De fait, dès les lendemains de la fameuse insurrection dite de Boukman qui ravagea la Plaine du Nord en Saint-Domingue, la grande île de Cuba va accueillir un contingent qui ira croissant de colons et de nègres français rescapés de la tourmente. L'intense transfert technologique et financier engendré par ce flux migratoire va modifier en profondeur les structures économiques du pays d'accueil et y altérer pour longtemps les relations sociales. Dès lors, l'esclavage cubain se métamorphosa en un système de production des plus coercitifs lié aux lois du marché. Dans ces conditions, on assiste à une remontée de l'insurgence nègre liée tant à l'entreprise des révoltes d'esclaves qu'à l'activisme des libres de couleur tout au long de la première moitié du XIXe siècle. Partant, il convenait de s'attacher au processus d'internationalisation du conflit nègre à Cuba dont les...

Cet ouvrage interroge les formes que revêtent les mémoires, le rapport du politique au passé, le rapport de la société avec les experts et les chercheurs. Évoquer la question de la reconstruction d’une société après un épisode traumatique permet de retracer les filiations qui se font ou se défont au prisme de la mémoire et de l’histoire d’un pays. Le sujet principal est ici la guerre de Vendée, mais il aborde aussi d’autres conflits intraétatiques : Saint-Domingue devenue Haïti, l’Algérie, la Nouvelle-Calédonie du xvie siècle à nos jours. Ces contributions comparatives passent par l’archéologie, l’ethnologie, la littérature et l’histoire. Ce volume permet une meilleure compréhension de l’histoire et de la mémoire des guerres civiles telles qu’elles ont été pensées, écrites, reconstruites et transmises par les acteurs, les témoins, les contemporains, les historiens. Les douze textes, ponctués par les conclusions de Jean-Clément Martin, permettent de mieux entrer dans la fabrique des mémoires des guerres civiles d’hier et d’aujourd’hui.

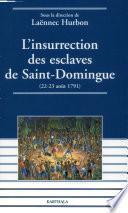
L'insurrection réussie de la nuit du 22 au 23 août 1791 des esclaves à Saint-Domingue est un événement inouï, sans précédent dans l'histoire universelle. Les textes rassemblés dans cet ouvrage constituent une contribution majeure à la recherche sur le sens et la portée de l'événement qui se situe à la genèse de la nation haïtienne. Un événement qui ouvre en même temps la voie à la chaîne des abolitions de l'esclavage au XIXe siècle. Cette table ronde internationale, organisée sous l'impulsion du projet Unesco " La route de l'esclave ", démontre une fois de plus qu'on est encore loin de pouvoir dépouiller et analyser tous les documents cachés et inexplorés dans les archives de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques. Le phénomène de la traite et de l'esclavage représente encore aujourd'hui et pour une large part un impensé du monde moderne.
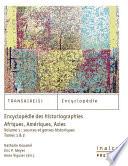
Quels rapports les sociétés humaines entretiennent-elles avec leur passé et quels récits font-elles du temps révolu ? Pour ce premier volume de l’Encyclopédie des historiographies. Afriques, Amériques, Asies, 157 spécialistes représentant 88 institutions académiques en France et dans le monde explorent l’univers des productions humaines qui constituent des sources pour l’historien et déchiffrent les nombreuses modalités (« scientifiques », littéraires, artistiques, monumentales...) de l’écriture du passé. Évoquant tour à tour l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, l’Océanie, les 216 notices de l’ouvrage présentent des matériaux historiques de toute nature, issus de toutes les époques, souvent méconnus, ainsi que l’histoire de leurs usages. L’entreprise collective qu’est l’Encyclopédie se veut novatrice : il s’agit de susciter une réflexion historiographique résolument non-occidentalo-centrée qui complète utilement les démarches épistémologiques traditionnelles. Nouvel outil de connaissance historique forgé à l’heure de la mondialisation, l’Encyclopédie des historiographies est aussi une véritable invitation au...
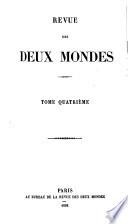

Le défi consiste à appréhender un mécanisme emblématique de la constitutionnalisation de ces pays. C'est-à-dire la conciliation entre la légitimité démocratique et la nécessité de la « puissance de l'État », élément historiquement ancré dans la région des Amériques. À travers leurs recherches, les auteurs entendent cerner ce qui fait la spécificité de cette dynamique afin de comprendre le passage de constitutions républicaines à des constitutions démocratiques contemporaines.

Haïti et le monde. Deux siècles de relations internationales présente sous forme chronologique l’histoire de plus de deux cents ans d’interaction entre Haïti en tant que nation indépendante et le monde. Les événements traités dans le texte sont choisis en fonction de leur importance ou de leur singularité dans l’histoire globale d’Haïti. Chaque fait analysé est mis en contexte avec, en conclusion, une liste de livres, d’articles de presse ou de revues scientifiques qui permettront aux lecteurs d’approfondir le sujet. L’actualité de ce livre est incontestable à un triple point de vue. D’abord, le livre est un véritable rappel et une conscientisation de l’intérêt historiographique de la dimension internationale d’Haïti. Il s’agit là d’un précieux apport pour comprendre les résurgences et l’apesanteur des rapports postcoloniaux pesant sur l’expérimentation des relations internationales et diplomatique d’Haïti dès sa naissance en tant qu’État jusqu’à l’époque de la construction de la démocratie. L’ouvrage a ensuite le mérite académique et intellectuel d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion et d’analyse dans...
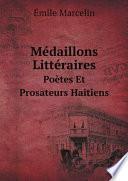


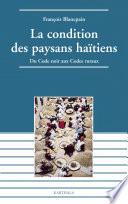
L'indépendance de la colonie de Saint-Domingue, proclamée le 1er janvier i804 sous l'ancien nom indien d'Haïti, mit les nouveaux chefs du pays dans la situation d'avoir à créer de toutes pièces un État. Ils disposaient pour ce faire des seuls viatiques d'une nation d'esclaves illettrés et des ruines fumantes des plantations coloniales. Parmi les principales questions qui se posaient, deux d'entre elles sont au cœur de cet ouvrage. À qui serait dévolue la propriété des terres des anciens colons ? Quelle serait l'étendue des droits et des libertés à accorder aux anciens esclaves pour qui l'abolition de l'esclavage signifiait le droit de givre sans travailler pour te compte d'un maître ? L'histoire chaotique de la République d'Haïti, ses coups d'État multiples baptisés du nom de révolutions, son peuple divisé en deux classes qui s'ignorent : 1a " République de Port-au-Prince ", c'est-à-dire la bourgeoisie, l'armée et la classe moyenne urbaine, et le " pays en dehors ", autrement dites paysans majoritaires, division qui se complique aujourd'hui du fait de la croissance incontrôlée de la masse des miséreux des bidonvilles, sont en grande partie la...


Un double numéro et une fertile réunion d’universitaires qui portent des regards croisés sur un concept aux limites mal évaluées : celui de créolisation culturelle. De la linguistique à l’architecture, de la musique aux rites, les auteurs qui ont apporté leur contribution au séminaire du CRILLASH sur la question (2011) cernent ainsi plus étroitement un processus, un perpétuel devenir presque, où se jouent rencontres, interpénétrations et recréations. Qu’ils soient théoriques ou attachés à des objets d’étude plus pointus, ces textes font ainsi plus que participer « au débat sur la créolisation, à son épistémologie, son exemplification » ; ils les repoussent et les enrichissent encore. Ethnologues et ethnomusicologues, critiques littéraires et historiens... on ne peut citer toutes les spécialités ici convoquées pour parler « créolisation ». Mais ce panorama non exhaustif suffit à lui seul pour dire toute l’ampleur et les infinies facettes d’un mouvement décelé, révélé et analysé par des auteurs qui, on l’aura compris, élargissent considérablement, avec acuité et limpidité, la recherche sur le sujet.
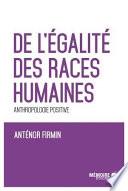
De l’égalité des races humaines appartient au grand mouvement des idées anthropologiques, sociologiques, philosophiques, historiques, littéraires et morales de la fin du XIXe siècle et restera actuelle tant que le racisme ne sera pas éradiqué de nos sociétés. Ghislaine GÉLOIN, professeur Au courant littéraire esclavagiste du XVIIIe siècle, succéda celui raciste du XIXe. En réponse, les esclaves firent par les armes Haïti et leurs théoriciens défendirent par les livres la race noire. C’est dans cette continuité que trois hommes haïtiens se sont levés pour combattre les thèses racistes en cours : Hannibal Price, Louis-Joseph Janvier, Anténor Firmin. Ce dernier s’en prendra en 1885 au champion toutes catégories du racisme, Arthur de Gobineau, et à son Essai sur l’inégalité des races humaines (1855), dans ce livre au titre visionnaire : De l’égalité des races humaines, un incontournable des 100 classiques de la bibliothèque bicentenaire haïtienne. George ANGLADE, géographe et écrivain
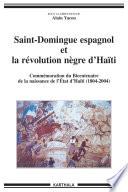
C'est au traité d'Aranjuez en 1777, au temps du Pacte de Famille entre les Bourbons, que la frontière a été formellement tracée entre les deux parties de l'île de Saint-Domingue. Plus tard, à l'époque de la Révolution française, lors de la fronde des Grands Blancs de la partie française, suivie de la révolte des mulâtres, puis de l'insurrection des esclaves au mois d' août 1791, l'" hypocrite cour de Madrid " tentera de récupérer le territoire de l'Ouest. En réalité, c'est tout le contraire qui arriva au Traité de Bâle en 1795, lorsque la partie espagnole sera cédée à la France. Dans la période de l'après-guerre (1795-1801), sous la conduite de Toussaint Louverture, passé au service de la République française, s'ouvre l'ère de la révolution nègre de Saint-Domingue dont on appréciera les résonances dans l'espace Caraïbe circonvoisin. On connaît la réponse du Premier Consul Bonaparte à la constitution louverturienne de 1801, mais l'échec de l'expédition Leclerc-Rochambeau qui s'en suivit ouvrira la voie à l'avènement de l'Etat d'Haïti en 1804. Tenant tête aux Pères de la Patrie haïtienne, le général Ferrand commandant le reste de...

« Mon esprit a toujours été choqué, en lisant divers ouvrages, de voir affirmer dogmatiquement l’inégalité des races humaines et l’infériorité native de la noire. Devenu membre de la Société d’anthropologie de Paris, la chose ne devait-elle pas me paraître encore plus incompréhensible et illogique ? Est-il naturel de voir siéger dans une même société et au même titre des hommes que la science même qu’on est censé représenter semble déclarer inégaux ? J’aurais pu, dès la fin de l’année dernière, à la reprise de nos travaux, provoquer au sein de la Société une discussion de nature à faire la lumière sur la question, à m’édifier au moins sur les raisons scientifiques qui autorisent la plupart de mes savants collègues à diviser l’espèce humaine en races supérieures et races inférieures ; mais ne serais-je pas considéré comme un intrus ? Une prévention malheureuse ne ferait-elle pas tomber ma demande, préalablement à tout examen ? Le simple bon sens m’indiquait là-dessus un doute légitime. Aussi est-ce alors que je conçus l’idée d’écrire ce livre que j’ose recommander à la méditation comme à l’indulgence des...


Haïti est la partie d'un culte vaudou original, à la fois relié à l'Afrique et fortement transformé sur place...
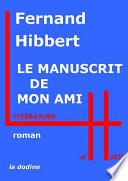
Par le biais du journal de Me Lambert-Trévier, Fernand Hibbert porte un regard sans concession sur la bourgeoisie haïtienne des années 1900.








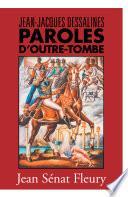
Juge de carrire, enseignant, crivain, Jean Snat Fleury est n en Hati. Sa large connaissance du droit hatien et sa grande comptence dans lart denseigner lont aid jouer un rle de formateur lAcadmie Nationale de Police en 1995 et de directeur des tudes lcole de la magistrature de Ption-Ville, en 2004. Auteur de limportant ouvrage Le Procs des Timbres: Laffaire Audubon, Me. Fleury a immigr aux tats-Unis, plus prcisment Boston, en 2007, o il a dcroch deux matrises lUniversit Suffolk, en administration publique et en sciences politiques. En 2014, Fleury a fond Caribbean Arts Gallery Boston, et par la suite, il devint directeur dune organisation de bienfaisance appele Art- For-Change dont le but est dencadrer les artistes.
Plus d'informations